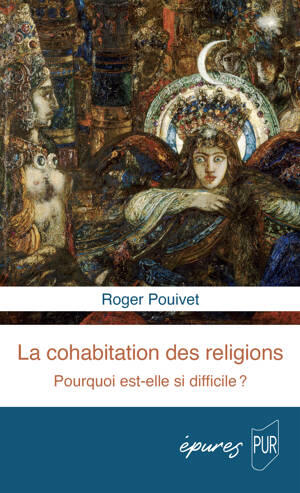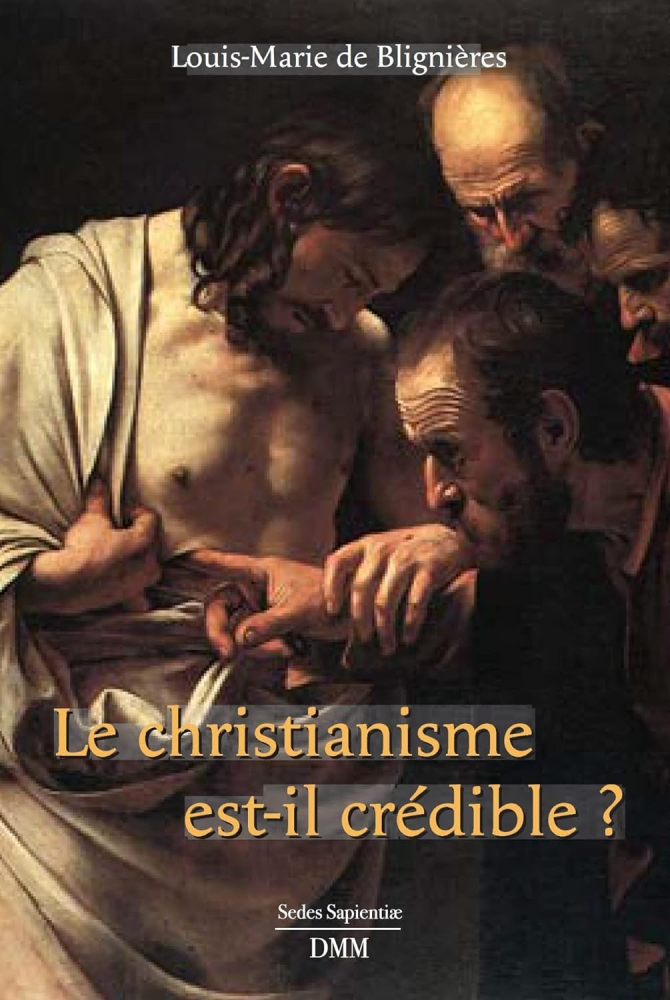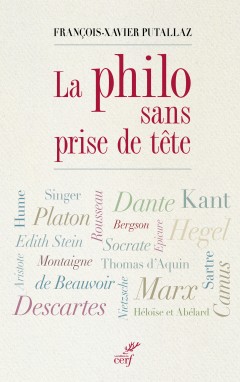Monseigneur l’archevêque, Monsieur le Maire, chers frères et sœurs,
Une des caractéristiques remarquables du couvent des Jacobins est la suivante : nous sommes en plein cœur de Toulouse, et pourtant nous ne sommes plus dans la ville. Le ronflement continu des moteurs, les bruits divers des machines et des hommes, l’agitation, l’énervement, toute cette activité fourmillante est absorbée par les épais murs de brique. L’église et le cloître accomplissent ainsi un office original sitôt qu’on y pénètre : ils nous offrent le présent du silence. Mieux, ils nous libèrent d’une submersion dont nous ne nous rendions même plus compte. Au cœur de la ville, voici que nous ne sommes plus soumis à la ville. L’effervescence et le tapage cessent d’être contagieux et de nous enchaîner à leur mécanique. Alors se produit un relâchement intérieur. L’âme retrouve la maîtrise d’elle-même. Elle se met à respirer parce que l’édifice est à sa mesure, il lui restitue les grands repères de la vie spirituelle : l’aspiration à l’élévation et à habiter une harmonie plus grande que nous, l’assise ferme et l’équilibre audacieux, l’alternance de la lumière et des ténèbres, les variations des couleurs et des sentiments, la parole qui retentit et le silence qui recueille, les rites qui accomplissent et les chants qui expriment le fond du cœur, l’assemblée qui n’est plus une masse anonyme. Dans cette église et ce cloître, grâce à eux, nous voici revenus à la vérité et à la mesure de ce que nous sommes. Alors, sous la bienveillante tutelle de saint Thomas d’Aquin, nous redevenons capables d’écouter Dieu qui parle.
Dieu a parlé ce soir sur les lèvres de Salomon (cf. Livre de la sagesse de Salomon 7, 7-16). Nous avons entendu ce roi nous confier comment il était devenu sage, et un modèle de sagesse. Il nous a dit avoir prié, supplié même, et nous imaginons sans peine un homme accablé par sa charge, assailli de soucis, dépassé par ses responsabilités, un homme qui ressemble fort à chacun de nous. N’avons-nous pas, chaque jour, quelque moment de découragement en voyant le chaos qui nous entoure, ou le chaos de notre propre vie, menaçant de nous emporter ? Salomon avait donc prié, supplié, et un esprit de sagesse était venu en lui. Cette sagesse lui avait rendu la maîtrise sur son existence et sur le gouvernement de sa nation. Dans les situations inextricables, il avait enfin su prendre de bonnes décisions ; dans les affaires insolubles, il avait pu trouver les voies de la justice ; dans les conflits interminables, il avait ramené la paix. C’est bien simple, ce don de l’esprit de sagesse avait été pour Salomon comme une entrée dans le couvent des Jacobins : être au cœur de la ville, mais ne plus être soumis à la ville ; être au sommet du pouvoir mais ne plus être écrasé par le pouvoir ; assumer le poids du quotidien mais ne plus être atomisé par le quotidien. Le rapprochement entre ce grand roi et nos Jacobins n’a rien d’artificiel. L’un comme l’autre témoignent des fruits de la sagesse dans l’homme. La sagesse élève, la sagesse rend l’homme à sa véritable dimension, la sagesse libère de l’emprise du chaos de ce monde. Pour peu que nous soyons sensibles à la sagesse qui a bâti les Jacobins, l’attachement de Salomon à la sagesse devient compréhensible. Cet attachement fut aussi celui de saint Thomas d’Aquin, qui a su en détailler les raisons.
En son origine première, explique-t-il, la sagesse n’est rien d’autre que Dieu qui se connaît parfaitement lui-même (cf. Commentaire sur Job, cap. 28, lect. 282-344). Ceci signifie que, dans l’intelligence divine, Dieu lui-même est pris comme le modèle de toutes choses. L’Artisan du monde tire ainsi de la connaissance de lui-même toutes les créatures, et leur ordre entre elles « avec poids, nombre et mesure », et leur ordre à la bonté divine qui est leur fin à toutes. Ainsi, la sagesse est en Dieu comme en son lieu originel, mais elle dérive comme en un second lieu dans l’univers des créatures que nous avons sous les yeux, à la manière dont l’architecte des Jacobins dériva la sagesse qu’il avait en lui-même dans l’ordre des pierres du couvent que nous avons sous les yeux. Or, continue Thomas, cette sagesse dérive encore de Dieu dans les créatures qui ont une intelligence. Car Dieu illumine les anges de sa sagesse, la sagesse divine se reflète en eux comme en un miroir. Et la sagesse divine dérive aussi sur les hommes lorsqu’ils connaissent la vérité avec leur raison. C’est pourquoi parmi tout ce que les hommes peuvent étudier, l’étude de la sagesse est l’étude la plus parfaite, la plus élevée, la plus utile et la plus agréable (cf. Somme contre les Gentils, Lib. I, cap. 2). — En effet, en étudiant la sagesse, l’homme se perfectionne à l’école de la sagesse qui est en Dieu, et cela lui donne part à la béatitude véritable. — De même, en étudiant la sagesse, l’homme devient plus sage et ressemble plus à Dieu, et cette proximité n’est rien d’autre qu’une amitié avec Dieu. En étudiant la sagesse, l’homme désire aussi le royaume éternel de la sagesse éternelle. — Enfin, en étudiant la sagesse, l’homme ne peut s’ennuyer ou se lasser car il y a une joie à vivre ainsi dans la société de Dieu. Béatitude, amitié, éternité et joie d’être avec Dieu. Voici donc les quatre fruits de la recherche de la vérité qui attachaient si fortement saint Thomas d’Aquin à la sagesse.
Pourtant il y a une condition pour obtenir ces fruits. Il faut certes prier et supplier pour recevoir la sagesse, mais cela n’est pas assez. Car l’homme n’est pas comme l’ange, il n’est pas ce miroir qu’un seul rayon divin suffit à illuminer. L’homme connaît par son corps, par les sens qui l’ouvrent sur le monde. Il commence donc sa vie comme une terre vierge, il a tout à découvrir et tout à apprendre. Tout ce que ses sens lui apportent sur un plateau, il lui faut l’assimiler avec sa raison, en réfléchissant, en pesant, en rassemblant, en organisant, en synthétisant. Pour l’homme, connaître la sagesse est indissociable du labeur de la raison, et consentir à ce labeur signifie qu’il faut rechercher la sagesse. Nul ne progresse, nul ne devient sage s’il ne cherche ardemment la sagesse qui le rend sage. Et pour chercher avec ardeur, il faut désirer inlassablement. Ce constat nous ramène à la suite du témoignage de Salomon. Pour grandir en sagesse, nous rapporte-t-il, il a dû la désirer au point de la préférer aux biens les plus attirants. Aux trônes et aux sceptres qui font le pouvoir, aux pierres précieuses et à l’or qui font la richesse, à la santé, à la beauté. Si l’on mettait devant lui tous les lingots d’or des banques de ce monde, ils lui paraîtraient comme du sable auprès de la sagesse.
En commentant ce témoignage de Salomon, saint Thomas souligne la justesse du parallèle (cf. Sermon Puer Iesus). Quand il nous manque quelque chose en ce monde, non seulement nous sommes satisfaits si on nous l’offre, mais nous sommes prêts à la rechercher avec empressement. Le commerçant par exemple n’hésite pas à franchir les mers et les airs pour rapporter de juteux contrats. De même doit-on travailler pour acquérir la sagesse en allant la chercher là où elle se trouve. Mais où la trouve-t-on ? Thomas indique trois lieux. D’abord auprès des maîtres, de ceux qui sont les plus sages et qui vont dériver leur sagesse sur nous, nous engendrant comme des pères de notre vie spirituelle. Ces maîtres sont non seulement ceux de notre époque, mais aussi les maîtres anciens, qui nous enseignent par les œuvres qu’ils nous ont laissées. Ensuite, l’étude des créatures nous ouvre à la sagesse qui façonne le monde, Dieu nous enseigne par ses œuvres lorsqu’on prend le temps de les regarder. Enfin, l’homme acquiert la sagesse en conversant avec d’autres, parce qu’il clarifie sa pensée lorsqu’il doit l’exprimer, et il la corrige ou la complète en écoutant ceux qui lui parlent.
Ainsi, Salomon, et à sa suite saint Thomas d’Aquin, nous tracent-ils une feuille de route finalement assez simple. L’homme est fait pour être sage, c’est-à-dire pour participer à la sagesse divine et goûter ses fruits de béatitude, d’amitié, d’éternité et de joie auprès de Dieu. C’est pourquoi l’homme doit prier pour demander la sagesse. Il doit ensuite la désirer plus que tout autre chose, et par conséquent chercher la vérité en faisant travailler sa raison et en allant acquérir la sagesse là où elle se trouve. À savoir auprès des maîtres les plus sages, dans la contemplation de la création, et dans les conversations où l’on échange sur la vérité. Cette feuille de route n’est pas réservée aux rois et aux docteurs en théologie, elle est valable pour chacun de nous car chacun de nous est fait pour être sage. Désirons-nous la sagesse plus que le reste ? Interrogeons-nous les grands maîtres ? Contemplons-nous les créatures ? Quel temps passons-nous à échanger sur la vérité ? Celui qui ne fait pas tout cela, pourquoi se plaint-il d’être dépassé par les événements, de ne pas savoir comment diriger sa vie, de prendre de mauvaises décisions, de ne pas trouver sa place dans la société, d’avoir le sentiment d’être ballotté à la surface d’un chaos et, finalement, de prendre ses distances avec Dieu ?
À la vérité, cette feuille de route valable pour tout homme de tous les temps projette aussi une lumière crue sur le chemin pris par notre société depuis quelques décennies. Car notre société a manifestement été façonnée par une recherche inlassable de la sagesse pendant de nombreux siècles. Les témoignages s’étalent sous nos yeux, depuis ce couvent et nos cathédrales jusqu’à nos avions et nos satellites, depuis notre agriculture jusqu’à notre opéra ou nos écrivains, depuis notre droit et notre organisation politique jusqu’à nos écoles et nos universités, depuis nos mœurs jusqu’à nos saints. Nous n’avons rien laissé à l’écart, rien n’a été laissé en friche. Toute l’histoire de notre France est une ode à la sagesse qui perfectionne parce qu’on l’a cherchée inlassablement. Et comment ne pas remarquer que cette histoire bimillénaire a été accompagnée et stimulée depuis ses débuts par la recherche de Dieu dans la vérité de la foi catholique, par l’attachement à la Sagesse engendrée unie à notre chair, Jésus-Christ notre Seigneur ?
Or voici que depuis quelques décennies beaucoup de choses ont changé dans notre société. Il n’y aurait pas lieu de s’en inquiéter si la recherche de la sagesse était restée à l’horizon de tous ces changements. Or c’est précisément le contraire qui s’est produit. L’usage de la raison a été détaché de la recherche de la sagesse pour être consacré à satisfaire nos désirs. Nous n’en avons pas vu les conséquences immédiatement, parce que le patrimoine de sagesse accumulé depuis des siècles continuait de nous porter. Sauf dans de petits cercles, notre société a simplement arrêté d’aller à la messe, arrêté d’étudier les grands sages, arrêté d’honorer les hommes illustres pour leur vertu, arrêté de transmettre la sagesse comme si son existence en dépendait, arrêté d’échanger généreusement sur la vérité, arrêté de célébrer la beauté, arrêté de s’interroger sur le juste et l’injuste, sur le bien et le péché. Même notre étude des créatures est devenue utilitaire. On a alors vu apparaître les slogans de la déconstruction en philosophie, en morale, dans les arts, les slogans du relativisme, de la post-histoire, de la post-religion et de la post-vérité. On a vécu au rythme des derniers gadgets, des nouvelles pubs, des infos en continu, des people, des animateurs télé, et des éléments de langage. N’étant plus préoccupée de rechercher la sagesse, la raison s’est mise à tourner sur elle-même, à vriller en elle-même, comme un instrument sans maître, un outil fait pour la technique et une technique faite pour être utile, tout n’a plus été qu’affaire d’expertise, de diagnostic, de procédure, d’optimisation, d’efficacité et de management. Il a suffi de quelques décennies, de quelques minuscules décennies pour commencer à voir apparaître les premiers fruits de ce nouveau régime de raison sans sagesse. Une société qui se fragmente, un dégoût ou un désespoir de vivre jusqu’à la dépression, la montée aux extrêmes dans le sarcasme et le vulgaire, la fuite dans la consommation et les addictions, l’ironie qui s’attaque à tout ce qui élève, la haine de soi, de sa nature et de son histoire, la dislocation des solidarités humaines et familiales, l’incapacité à s’engager et à tenir sa parole, la défiance croissante à l’égard des politiques, de l’éducation, des journalistes, des policiers et des juges, la criminalisation des pensées et des arrière-pensées, l’incapacité à discuter sans invectives. Les grands mouvements de protestation de ces dernières années ne sont que la part exprimée de ce grand désarroi.
Jusqu’où ce mouvement ira-t-il ? Qu’adviendra-t-il de notre société ? Dieu seul le sait. Mais nous savons les causes et le remède. Ce que Dieu nous a enseigné par la bouche de Salomon, les dernières décennies se sont chargées de vérifier que cela était vrai. Une société mise au régime de la raison sans recherche de la vérité dilapide son patrimoine de sagesse et s’épuise dans la technique mise au service de la satisfaction des désirs. Nous savons aussi que le renversement de ce mouvement d’auto-destruction tient à peu de chose. Il suffit de renouveler l’expérience de Salomon, l’expérience de Thomas d’Aquin, l’expérience des Jacobins : être dans la ville, mais ne plus être soumis à la ville en recouvrant les véritables dimensions de l’âme. L’homme est fait pour la sagesse parce qu’il est fait pour connaître et aimer Dieu. Et s’il suit la voie pour laquelle il est fait en recherchant la vérité inlassablement avec ses semblables, alors ses œuvres contribuent à bâtir une société à hauteur d’homme, spirituellement vivante, et donc durable. Nous avons à notre disposition tout ce qu’il faut pour une telle renaissance. Nous avons des maîtres de sagesse pour nous enseigner et nous en avons même un parmi les plus grands à portée de main, que nous vénérons dans cette église. L’œuvre de la création est là, qui ne demande qu’à être contemplée. Il y aurait encore à retrouver le désir ardent des échanges sur la vérité. Avec de tels atouts, sous le patronage de saint Thomas d’Aquin, Toulouse pourrait bien devenir capitale de la recherche de la sagesse. Puisse ce que nous vivons ce soir, en plein cœur de la ville sans être soumis à la ville, devenir notre point de repère pour renouveler notre désir de la sagesse.
Seigneur, je te prie, je te supplie, par l’intercession de saint Thomas d’Aquin, que ton esprit de sagesse vienne en chacun de nous.