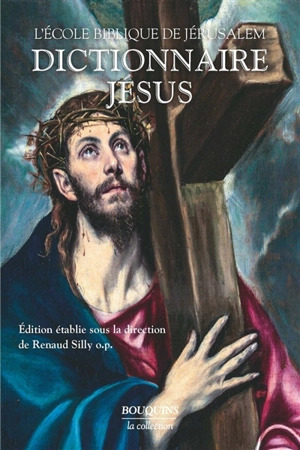Durant l’année scolaire 1269-1270 (du moins est-ce la date la plus probable), saint Thomas d’Aquin commente l’Évangile selon saint Matthieu. Il séjourne alors à Paris et s’adresse à ses étudiants de l’université, lesquels prennent les cours du Maître en note. Le texte dont nous disposons aujourd’hui porte doublement la marque de son origine : il s’agit d’un script de cours, non corrigé par l’auteur du cours. Sa lecture n’est toutefois pas sans fruits, comme on va s’en apercevoir.
Saint Thomas n’est pas un auteur spirituel ordinaire. Pour lui, l’Écriture sainte est un enseignement de Dieu, qui nous instruit sur ce qui est à croire et ce qui est à faire. Et
« c’est surtout dans l’Évangile que nous est transmise la substance de la foi catholique et la règle de toute vie chrétienne » (Catena in Mt, Prol.)
Par conséquent, lorsque Thomas expose l’Évangile, il ne cherche pas à partager un enseignement personnel, mais à nous faire accéder à Dieu qui nous parle, afin que nous écoutions les vérités qu’Il nous dit et mettions en pratique ce qu’Il nous demande. Et lorsque Thomas commente la Passion (Mt 26, 47–27, 56), il ne nous présente pas sa vision de la Passion, mais il entend nous introduire auprès du Christ qui enseigne en sa Passion. Or le Christ ne dit quasiment rien : ce qui compte, ce qui nous enseigne, comme le mot passion l’indique, c’est ce que le Christ pâtit. Comment le récit de ce pâtir constitue-t-il un enseignement ?
Comment Dieu parle dans la Passion
Il faut revenir un instant à la manière dont Dieu dispose toutes choses. Parce qu’Il est « Seigneur du ciel et de la terre » (Mt 11, 25), tout est dans sa main, y compris le cours de tous les événements qui sont rapportés par l’évangéliste. Depuis la gifle d’un garde jusqu’au tremblement de terre lorsque meurt le Christ, depuis le froid de la nuit duquel on s’échappe en se pressant autour d’un feu jusqu’à la lance du soldat romain, depuis les pensées de Caïphe jusqu’aux regards de la Vierge Marie devant la Croix, tout est là parce que Dieu le veut dans sa Sagesse, parce qu’Il en a disposé ainsi dans sa providence. Tout ce qui arrive a donc un sens.
Ce sens n’échapperait pas totalement à quelqu’un qui lirait une Vie de Jésus contemporaine ou qui consulterait, par exemple, l’historien juif de l’époque, Flavius Josèphe. Il pourrait ainsi saisir quelque chose des motifs du garde, de la forme de la lance, de la foule de Jérusalem ou de la haine de Caïphe, il pourrait comprendre que Jésus est mort sur une croix, après un procès qui avait tous les traits d’un montage destiné à le condamner. Mais cela, comme tout ce que pourraient lui apprendre d’autres hommes, reste à la surface du sens de l’événement. Si Dieu n’avait pas inspiré les évangélistes, afin qu’ils rapportassent l’événement en révélant son sens profond, celui que Dieu a voulu, alors le sens de la Passion nous serait irrémédiablement fermé. Dieu nous aurait sauvés, mais nous n’aurions aucun moyen de comprendre comment, et nous nous épuiserions à faire des devinettes et monter des théories, toutes plus fumeuses ou bancales les unes que les autres (la littérature à ce sujet est innombrable, depuis les anciens récits gnostiques jusqu’à Hegel ou Éric-Emmanuel Schmitt).
« Les réalités qui dépendent de la seule volonté de Dieu et auxquelles la créature n’a aucun droit ne nous sont connues que dans la mesure où elles nous sont livrées dans l’Écriture sainte, par laquelle la volonté divine se fit connaître à nous. » (Sum. theol., IIIa, q. 1, a. 3, resp.)
Mais il y a plus. D’une part, il faut éclairer ce que Dieu fait, tel que saint Matthieu nous le montre, par ce que Dieu avait annoncé qu’il ferait, et que nous trouvons dans l’Ancien Testament. D’autre part, il faut garder les yeux fixés sur le Christ, recueillir précieusement ce qu’il agit et ce qu’il pâtit. Car le Christ nous dévoile alors ce qu’il veut agir et ce qu’il veut pâtir. Cette volonté, ces actions, ces passions, sont bien sûr humaines, et c’est en cela qu’elles nous parlent. Mais elles sont aussi l’expression humaine de ce que le Fils de Dieu veut agir et pâtir dans sa chair car, dans le Christ, la volonté humaine épouse parfaitement le vouloir divin, et l’opération humaine est l’instrument conjoint de l’opération divine.
« Dans le Christ, l’humanité se présente à la manière d’un instrument (organum) de la divinité. Or il est clair qu’un instrument agit dans la vertu de l’agent principal. De sorte que dans l’action de l’instrument on ne trouve pas seulement la vertu de l’instrument, mais aussi celle de l’agent principal. Par exemple, c’est par l’action de la scie que l’on fabrique un placard, [mais c’est par la scie] en tant qu’elle est dirigée par l’artisan. De même, donc, l’opération de la nature humaine dans le Christ possédait, venant de la divinité, une certaine force dépassant la vertu humaine. Que le Christ touchât un lépreux, c’était l’action de l’humanité, mais que ce toucher guérît de la lèpre, cela provenait de la vertu de la divinité. Et de cette manière toutes les actions et passions humaines [du Christ] eurent un effet salutaire par la vertu de la divinité. C’est pourquoi Denys appelle “théandrique” l’opération humaine du Christ, c’est-à-dire divino-humaine, parce qu’elle provenait de l’humanité tout en étant gorgée de la vertu de la divinité. » (Comp. theol., I, c. 212)
On peut donc dire que saint Thomas nous apprend à regarder la Passion du Christ comme un mystère en train de se manifester. Par les détails que l’évangéliste a retenus, par les échos de l’Ancien Testament qui se réalisent sous nos yeux, par l’attention à ce que le Christ montre qu’il veut agir et pâtir. Saint Matthieu lui-même nous instruit de ce dévoilement du sens lorsqu’il rapporte, au moment de la mort du Christ, que le rideau du sanctuaire, dans le Temple de Jérusalem, se déchira par le milieu : Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas (Mt 27, 51).
« Dans le Temple, il y avait un double voile, comme dans la Tente [de la rencontre, cf. Ex 26, 31–37], car il y avait un voile dans le Saint des Saints, et il y avait un autre voile, qui n’était pas dans le Saint. Et ces deux voiles symbolisaient une double occultation (velatio), car le voile intérieur signifiait l’occultation des mystères célestes, qui nous seront révélés. Alors en effet nous Lui serons semblables, lorsque sa gloire apparaîtra [cf. 1Jn 3, 2 ; Rm 8, 18 ; 1Co 13, 12 ; Col 3, 4]. L’autre voile, qui était à l’extérieur, signifiait l’occultation des mystères qui se rapportent à l’Église. C’est donc ce second voile qui fut déchiré, pas le premier, pour symboliser que des mystères ont été manifestés par la mort du Christ, ceux se rapportant à l’Église. Le premier voile en revanche n’a pas été déchiré, car les secrets célestes demeurent voilés jusqu’à maintenant. C’est pourquoi l’Apôtre dit en 2Co 3, 15–16 : aujourd’hui encore, quand les fils d’Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur mais quand ils auront été convertis, le voile sera retiré. C’est pourquoi par la passion [du Christ] tous les mystères, qui sont écrits dans la Loi et les prophètes, furent dévoilés, comme on le voit à la fin de Luc, v. 27 : et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. »
Alors, lorsque ce mystère se dévoile, le sens de la Passion apparaît car nous sommes instruits de la « substance de la foi » et de la manière dont cette Passion doit changer notre vie en l’inspirant.
L’ordre des choses : le salut par la foi
Pour entrer dans la compréhension de ce qui se passe, il faut d’abord en considérer l’ordre. Dans la Passion selon saint Matthieu, saint Thomas discerne trois parties :
1. Ce que le Christ subit des juifs (Mt 26, 47–75).
2. Ce que le Christ subit par les gentils (Mt 27, 1–26).
3. La passion et la mort (Mt 27, 27–56).
On voit d’emblée que cette division s’attache à ce que le Christ pâtit, d’abord des hommes, puis par leur fait. Les deux premières parties se développent chez saint Matthieu de manière identique :
- Jésus est arrêté par les juifs, puis interrogé, puis condamné ;
- il est alors livré aux gentils, puis est à nouveau interrogé, puis à nouveau condamné.
Ce parallélisme est instructif : Jésus a pâti par les juifs et par les gentils, tous ont pris part à la mort du Fils de Dieu, afin que tous soient sauvés par le Fils de Dieu. Mais Dieu a disposé qu’il y aurait un ordre entre eux car, comme le rappelle Jésus à la samaritaine, « le salut est venu par les juifs » pour être ensuite répandu aux païens (Jn 4, 22). C’est donc cet ordre théologique qui prévaut chez Matthieu :
« le Seigneur dit en Mt 20, 19 : Ils le livreront aux païens pour qu’il soit outragé, flagellé et crucifié. L’effet de la passion du Christ a été préfiguré dans ses circonstances mêmes. Or son premier effet salutaire s’est vérifié sur les juifs, dont beaucoup ont été baptisés dans la mort du Christ, ainsi qu’on le voit dans les Actes des Apôtres (2, 41 et 4, 4). En second lieu, grâce à la prédication des juifs, l’effet de la passion du Christ s’est étendu aussi aux paiens. Il était donc convenant que le Christ commence à souffrir de la part des juifs, et que, par la suite, les juifs l’ayant livré, sa passion soit achevée par la main des païens » (Sum. theol., IIIa, q. 47, a. 4, resp.)
La troisième partie, sur la passion et la mort, comporte elle-même des subdivisions. Ce qui frappe Thomas est le contraste entre ce que le Christ endure et les signes grandioses qui se déploient, montrant d’un côté l’abaissement du Fils de Dieu et de l’autre les manifestations de la puissance de Dieu.
- Ce qu’il a enduré indûment : la dérision des soldats ; la crucifixion ; la dérision par les juifs.
- Les signes grandioses : (avant la mort) l’éclipse et le dernier cri ; (après la mort) la mort, la stupeur face à la mort, l’effet des miracles.
Ce contraste n’est pas anodin. Les signes grandioses montrent que dans la plus complète passion se réalise la plus grande action : ce que le Christ subit dans sa chair est l’instrument visible de l’opération invisible, à la manière dont nous avons vu qu’en touchant le lépreux avec son doigt Jésus le guérissait. C’est pourquoi il ne faut pas dissocier les signes grandioses de la passion, ni en minimiser l’importance : ils sont le soutien de la foi (comme en atteste le centurion romain), qui entre dans le mystère de ce qui se passe.
Au total, l’ordre suivi par saint Matthieu centre notre attention sur deux points : la Passion comme source du salut pour tous les pécheurs, les juifs puis les païens ; la Passion comme mystère présenté à la foi, où l’abaissement du Christ en sa chair est sa suprême activité divine.
Quelques illustrations permettront d’approfondir cette compréhension d’ensemble. Nous guiderons la lecture seulement pour les premières.
Judas la “balance” (Mt 26, 47–50a)
La première passion infligée au Christ dans la Passion vient d’un proche, choisi par lui : Judas, l’un des douze. Saint Thomas prend soin de relever tous les détails destinés à notre instruction. Ainsi,
« Matthieu indique sa dignité, l’un des douze, car bien qu’il fût établi dans une telle dignité, il en déchut cependant par son forfait. En cela est donné un exemple : personne ne doit mettre sa confiance dans son statut ou sa fonction. Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber prévient saint Paul (1Co 10, 12). Jésus leur avait dit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l’un de vous est un diable ! (Jn 6, 70). Pourquoi alors Jésus l’a-t-il choisi, puisqu’il savait le mal qu’il allait commettre ? Une raison est qu’il a donné un exemple aux prélats, afin qu’ils ne desservent pas. »
Judas vient accompagné d’un groupe en armes :
« De même qu’il avait une âme féroce, de même s’entoura-t-il d’une société féroce, car tout animal a de l’appétit pour ce qui lui ressemble. C’est ce que Matthieu souligne lorsqu’il précise qu’il s’agissait d’un grand groupe. En quoi l’on voit qu’ils étaient stupides, car les stupides aiment être en masse (cf. Qo 1, 15). Et de fait ils étaient bien stupides, eux qui venaient s’affronter à [celui qui est] la Sagesse. »
Or le signe par lequel Judas “balance” son Maître est stupéfiant :
« Il leur donna un signe singulier : Celui que j’embrasserai, c’est lui, emparez-vous en. Il a fait du signe de l’amitié le signe de la “balance” (Signum amicitiae fecit signum proditionis). Comme le dit Pv 27, 6 : meilleures sont les blessures d’un ami, que les baisers trompeurs de l’ennemi. »
Thomas s’arrête alors un instant pour méditer sur cette manière de trahir, sur la psychologie de celui qui salue en embrassant pour mieux frapper. Il l’éclaire par un épisode rapporté dans le livre de Samuel (2S 20, 1–13) où Joab salue Amasa en l’appelant “mon frère”, va comme pour l’embrasser mais lui transperce violemment le côté de son épée et le tue.
À cette anti-amitié répond, dans un contraste saisissant, l’amitié vraie de Jésus : « Ami, qu’es-tu venu faire » dit-il à Judas. La tonalité de cette réponse peut s’interpréter de deux manières. On peut d’abord la lire comme une interrogation où résonne le reproche :
« C’est comme si Jésus disait : tu montres de l’amitié par le baiser, et tu viens pour me perdre ? Ce qui rappelle le Ps 27,3 : ils parlent de paix dans leur bouche, mais dans leur cœur c’est le mal. S’il l’appelle donc “ami”, ce serait pour lui reprocher son acte. On trouve la même expression dans la parabole du festin des noces (Mt 22, 12) : ami, comment es-tu entré, en n’ayant pas l’habit de noces ? ; et dans la parabole des ouvriers de la onzième heure (Mt 20, 13) : mon ami, je ne t’ai fait aucun tort. [Ce qui confirme] 1Jn 4, 19 : ce n’est pas nous qui l’avons aimé le premier, mais c’est lui qui nous a aimés d’abord. »
Mais on peut aussi entendre dans ce « Ami, qu’es-tu venu faire » une atténuation plutôt qu’un reproche :
« Alors ce n’est pas une parole de blâme mais une parole qui permet : Ami, c’est pour cela que tu es venu, à la manière dont il avait dit (Jn 13, 27) : Ce que tu fais, fais-le vite. Il l’appelle alors ami pour ce qui est de lui car, suivant les mots du Ps 119, 7 : avec ceux qui haïssent la paix, j’étais pacifique. Bien qu’il sût qu’il venait l’embrasser, il est cependant allé au-devant de lui. »
Voici donc la trahison de Judas. D’un côté elle est la première passion du Christ, Sagesse de Dieu, vrai ami des hommes, pacifique. De l’autre, elle vient de l’un de ceux qu’il avait choisis, un qui profite de son statut d’apôtre, qui a l’âme dure, qui se rassure dans la compagnie des brutes, qui embrasse celui qu’il livre.
Caïphe le grand-prêtre inique (Mt 27, 63–64)
L’interrogatoire de Jésus par Caïphe et le conseil suprême se passe mal. Ils avaient prévu de constituer un vrai tribunal, devant lequel ils appelleraient des témoins qui permettraient de coincer Jésus et de tenir un motif de condamnation à mort. Le premier grain de sable vint de l’absence de témoins. Qu’importe, on en trouva de faux ! Mais cet expédient avait dû être décidé en catastrophe, car les témoignages se contredirent entre eux. Sentant la situation lui échapper, le grand prêtre était alors sorti de son rôle de juge pour interroger directement Jésus en essayant de le piéger. Nouvel échec ! Caïphe, excédé, se mouille complètement. Il se dresse face à Jésus : Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Or explique Thomas, « adjurer, c’est forcer à jurer », contraindre à prêter serment. Bref, c’est l’ultime recours. L’échange qui suit montre la confrontation de Caïphe et du Fils de Dieu !
Tout d’abord, Jésus sort de son silence et répond :
« Notez que lorsqu’on faisait quelque chose contre lui il se taisait. Mais aussitôt que la puissance du Père fut prise à partie, il répondit. Où l’on voit qu’il cherchait toujours la gloire du Père. Jn 8, 50 : Moi je ne cherche pas ma gloire. »
Or cette réponse ne consiste pas à affirmer directement qui il est, mais à citer des autorités qui attestent de son identité : je vous le déclare : désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Cette phrase associe en effet le Ps 109, 1 et Dn 7, 7 :
Ps 109, 1 : « le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône » (Jésus avait utilisé le même verset pour attester de sa filiation divine en Mt 22, 42–46).
Dn 7,7 : « Je regardais dans la vision de la nuit, et voici qu’avec les nuées du ciel venait comme un fils d’homme »
Saint Thomas s’attarde particulièrement sur cette attestation de l’identité du Christ. Il montre tout ce qu’elle enseigne au sujet de sa seigneurie, aujourd’hui et jusqu’au dernier Jour. Or si Caïphe veut croire que la Parole de Dieu a l’autorité de Dieu, ce n’est pas pour croire à ce qu’elle dit et pour lui obéir, c’est seulement pour qu’elle serve ses volontés à lui, et que la Parole de Dieu lui serve à condamner le Verbe de Dieu lui-même. Il tient donc sa condamnation : Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : “Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d’entendre le blasphème !” Ce faisant, Caïphe accomplissait le dessein de Dieu :
« En condamnant Jésus, le grand-prêtre montre la culpabilité par le geste et par la parole. Par le geste car il déchire ses vêtements. C’est avec la même fureur qu’il déchire ses vêtements et qu’auparavant il s’était levé de son siège. Il était en effet d’usage que ceux qui entendaient un blasphème déchirassent leur vêtement pour signifier que c’était insupportable à entendre.
Qu’il ait fait ces deux gestes, cela a vraiment un sens : en se levant de son siège il avait montré qu’il avait abandonné le sacerdoce, et en déchirant ses vêtements il signifiait que le sacerdoce devait être remplacé. He 7,12 : s’il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement aussi changement de loi. La tunique du Christ au contraire ne fut pas découpée. Jn 19,24 : ne la divisons pas, mais tirons-la au sort pour voir qui l’aura.
Ainsi il signifiait une abolition. Et cela avait été annoncé en 1S 15,28 : Alors Samuel lui dit : Aujourd’hui, le Seigneur t’a arraché la royauté sur Israël et il l’a donnée à ton prochain qui vaut mieux que toi. Ainsi le sacerdoce est-il arraché aux juifs et est donné aux membres du Christ. »
Prenons un peu de recul pour apprécier la situation. Il y a d’abord la condamnation à mort de Jésus.
« Il mérite la mort prononcent les juges selon le jugement de la loi. Or cela aurait été vrai s’il y avait eu blasphème. Mais ce n’était pas le cas, et c’est pourquoi ils ont rendu un mauvais jugement, car ils ont condamné à mort l’Auteur de la vie. 1Co 15,22 : Comme la mort en effet par Adam est passée à tous les hommes, ainsi la vie par Jésus.
De même en va-t-il de Caïphe. Il n’était pas un grand-prêtre légitime, n’étant pas descendant d’Aaron.
« Il ne faut pas s’étonner qu’un juge inique ou un prince inique rende un jugement inique. Or cela convenait au mystère. De même en effet que la passion du Christ était l’oblation du vrai sacrifice, de même cette maison du pontife Caïphe devait servir [à la condamnation à mort], pour que le Christ, qui est prêtre pour l’éternité, soit offert. » (sur Mt 26, 57)
En définitive Caïphe est parvenu à ses fins. Mais à quel prix ? Pour que le Christ pâtisse par lui, il a été conduit à bafouer la justice, à recourir au mensonge, à prendre la place de l’accusateur, à refuser de croire aux prophéties, à instrumentaliser l’autorité divine, à corrompre l’institution du grand-prêtre et à lier le conseil suprême à son indignité.
« Les chefs du peuple voyaient des signes évidents de sa divinité mais, par hostilité et par haine du Christ, ils en détournaient le sens et ils ne voulurent pas croire aux paroles par lesquelles il se disait Fils de Dieu. C’est pourquoi il pouvait dire d’eux (Jn 15, 22) : Si je n’étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché, mais maintenant ils n’ont plus d’excuse pour leur péché. Et il ajoute un peu plus loin (v. 24) : Si je n’avais pas accompli parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de péché. Et c’est pourquoi on peut leur attribuer ce que dit Job 21, 14 : Ils ont dit à Dieu : Écarte-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » (Sum. theol., IIIa, q. 47, a. 5, resp.)
« À propos de la phrase du Christ : vous comblez la mesure de vos pères, saint Jean Chrysostome explique : Il est bien vrai qu’ils ont dépassé la mesure de leurs pères : car leurs pères ont tué des hommes mais, eux, ils ont crucifié Dieu. » (Sum. theol., IIIa, q. 47, a. 6, s.c.)
La dérision des soldats (Mt 27, 27–31)
Après la trahison de l’ami, après l’atteinte à la dignité et à l’innocence, voici une illustration de la passion dans le corps. Saint Thomas commence par remarquer qu’elle est dans le prolongement de la condamnation, elle en imprime corporellement le motif.
« Il faut noter que, bien qu’ils l’aient accusés de nombreux faits, cependant le Seigneur n’a pas pâti pour un autre motif que celui de s’être dit “roi” […] C’est pourquoi, voulant s’en moquer, ils lui ont imposé les insignes du roi […].
C’est pourquoi la dérision des soldats n’est pas sans signification. Signification pour ceux qui l’infligent, mais aussi signification en mystère, qui porte sur chacun des trois insignes de la royauté du Christ. D’abord le Christ est roi dans sa passion en étant vraiment homme, c’est-à-dire en versant son sang à cause de nos péchés :
[La robe pourpre] En ceci qu’il a été dépouillé de ses propres vêtements et revêtu d’autres, les hérétiques sont réfutés, car ils ont dit qu’il n’était pas vraiment homme. Cette chlamyde peut symboliser la chair du Christ ensanglantée de son propre sang. Is 53, 5 : Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Cela peut aussi renvoyer au sang des martyrs, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. Ou encore au péché des gentils.
Ensuite le Christ est roi dans sa passion en ayant subi l’affliction intérieure, la tristesse de l’âme venant de l’offense à Dieu. Et ce ne fut pas la tristesse seulement à cause du péché des soldats, mais à cause de tous les péchés depuis Adam. La Passion produit son effet à l’égard de tous, et c’est pourquoi il règne sur tous :
[La couronne d’épines] Pour toute couronne de gloire, ils lui ont imposé la couronne de l’outrage. Is 22, 18 : couronnez-le d’une couronne d’épreuves [1]. Par ces épines sont symbolisées les aiguillons des pécheurs, par lesquelles sa conscience fut blessée. Et le Christ les a reçues pour nous, car c’est pour nos péchés qu’il est mort. On peut aussi penser à la malédiction d’Adam : le sol te donnera épines et chardons (Gn 3, 18). Était ainsi signifié que la malédiction d’Adam était rompue.
Enfin, le Christ est roi dans sa passion à l’égard de tous ceux qui exercent un pouvoir dans le monde : le Démon qui tient les hommes soumis à leurs désirs mauvais, les puissances de ce monde qui s’enorgueillissent dans leur force, les erreurs qui égarent, les violents qui oppriment.
[Le sceptre de roseau] Selon Origène, il symbolise le pouvoir du Démon, que le Christ a arraché de ses mains, selon 2R 18, 21 : Voici que tu as mis ta confiance dans le soutien d’un roseau brisé, l’Égypte. Il peut aussi signifier la vanité des gentils, que cependant le Christ assumée. Ps 2, 18 : Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. Il sont en effet bien comparables au roseau, car comme le roseau est emporté à tout vent, ainsi les gentils le sont-ils à toute erreur. Ou encore, le roseau est utilisé pour écrire autant que pour frapper à mort. Ainsi le Christ attire à lui ses fidèles pour les inscrire [au nombre des élus], tandis que les persécuteurs c’est pour les mettre à mort. »
Saint Thomas ne manque pas de noter que le Christ aux outrages est un exemple pour tous ceux qui souffrent l’humiliation en témoignage de leur foi, qui demeurent fidèles dans le martyr. Exemple qui n’est pas seulement une image à laquelle se référer, mais exemple en ce qu’il est la source de la grâce donnant au chrétien de demeurer fidèle.
Les commentaires qui précèdent devraient suffire à comprendre comment Thomas nous aide à entrer dans l’intelligence du mystère de la Passion du Christ. Continuons à suivre quelques moments de cette Passion avec Thomas pour seul guide.
Le crucifiement (Mt 27, 34)
« Il voulurent que tous ses sens pâtissent. La vue avait pâti par les crachats et l’insomnie, l’ouïe par les blasphèmes et les paroles de moquerie, le toucher car il avait été flagellé. C’est pourquoi ils voulurent que le goût souffrît aussi. Ainsi s’achevait ce qui est dit au Ps 68, 22 : dans ma faim ils m’ont donné du fiel, et dans ma soif m’ont fait boire du vinaigre. De même Jr 2, 21 : j’avais fait de toi une vigne de raisin vermeil, tout entière d’un cépage de qualité. Comment t’es-tu changée pour moi en vigne méconnaissable et sauvage ? Surgit alors cette question : Mc 15, 23 tient qu’ils lui ont donné du vin mêlé de myrrhe. Il faut dire que la myrrhe est très amère, et que le vin mêlé de fiel est aussi amer. Mais l’habitude est d’utiliser “fiel” pour tout ce qui est amer. Ainsi, selon la vérité, le vin était avec de la myrrhe, et cependant on dit qu’il ressemblait au fiel. Par ceci était signifié qu’il a porté l’amertume de nos péchés.
Après cela est évoqué comment il l’a reçu, en disant que l’ayant goûté il ne voulut pas en boire. Pourquoi saint Marc dit-il qu’il en prit, alors qu’ici il est dit qu’il y a seulement goûté ? On pourrait répondre qu’il n’en a pris que pour y goûter. Et ceci a valeur de symbole, car il a “goûté” la mort : il a en effet promptement ressuscité, et il a à peine été vu mort, car il était libre parmi les morts, comme le dit le Ps 87, 6.
On peut alors se demander pourquoi il a davantage voulu mourir de cette mort-là.
1. Une première raison vient de ceux qui l’ont crucifié, car ils voulaient qu’elle soit infamante, suivant ce qu’on trouve en Sg 2, 20 : condamnons-le à la mort la plus honteuse, et c’était la croix.
2. Cela tenait aussi à l’ordre des choses établi par Dieu, car le Christ voulait être notre Maître, pour nous donner l’exemple du pâtir dans la mort. D’où vient qu’il a pâti la mort pour nous libérer par la mort, comme l’explique l’Épître aux Hébreux, 2, 14s. Car nombreux sont ceux qui veulent bien pâtir la mort mais qui reculent devant la déchéance dans la mort. C’est pourquoi le Seigneur a donné l’exemple pour qu’ils ne reculent devant aucun genre de mort.
3. Cela appartenait aussi à la rédemption, car il fallait bien une satisfaction pour le péché du premier homme. Or le premier homme avait péché par le bois, et c’est pourquoi le Seigneur a voulu pâtir par le bois. Comme le dit Sg 14, 7 : bienheureux bois, par lequel a été fait justice.
4. Le Christ devait être exalté par la passion, et c’est pourquoi il a voulu être exalté par une passion sur la croix.
5. Il voulait encore attirer nos cœurs à lui. Jn 12, 32 : lorsque je serai exalté de terre, j’attirerai tout à moi. Et ainsi nos cœurs seraient élevés. »
La dérision par les juifs (Mt 27, 42–43)
« Il en a sauvé d’autres, et il ne peut se sauver lui-même, disent les chefs des juifs. Ils voulaient dire : s’il en avait sauvé d’autres, il pourrait se sauver ; mais qu’il ne le puisse pas montre qu’il n’en a pas sauvé d’autres. Mais nous, au contraire, nous devons rétorquer : il en a sauvé d’autres, et donc il peut se sauver ; et s’il a pu se sauver en ressuscitant, alors il pourra nous sauver. He 5, 9 : conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Où l’on voit que ceux qui l’insultaient ne visaient rien d’autre qu’un salut temporel, tandis que le Christ voulait montrer que le salut éternel est à préférer.
De là vient qu’ils disent : s’il est le roi d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix. En cela ils insultaient la dignité royale, et faisaient une fausse promesse, et commettaient encore un autre mal, car s’il est le roi d’Israël, il ne devrait pas descendre lui qui par la croix devait monter. Ps 95, 10 : Le Seigneur a régné par le bois [anciennes versions latines]. Et Is 9, 6 : sa prééminence, c’est-à-dire la croix, a été établie sur ses épaules. De même a-t-il fait ce qui est plus grand [que descendre de la croix], car il a surgi du tombeau, et cependant ils n’ont pas cru, ce qui fait d’eux des menteurs. Jr 23, 16 : N’écoutez pas les paroles de ces prophètes qui prophétisent pour vous et vous trompent. Et Jérémie continue : Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui sort de la bouche du Seigneur.
Plus encore, ils lui reprochaient de se dire Fils de Dieu : il se confie à Dieu, qu’il le libère s’il le veut. Ps 21, 9 : il espérait dans le Seigneur, qu’il le libère, qu’il le sauve puisqu’il est son ami. Dieu pouvait le libérer, s’il l’avait voulu. Mais il ne le voulait pas, car il voulait l’exposer à la mort pour un temps, afin de nous procurer le salut, et de recouvrer son honneur. C’est ainsi que s’accomplit Jr 15, 10 : ils disent toute sorte de mal contre moi. »
La mort (Mt 27, 51)
« La cause de sa mort fut triple.
— Une première cause fut de montrer combien il nous a aimés. Augustin dit : il n’y a pas de meilleure raison de l’amour que de prendre les devants en aimant. Rm 5, 8 : la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.
— La deuxième était de nous enseigner à ne pas craindre la mort. Par la mort, le Christ a détruit tous les péchés. Et il a ôté la peine du péché d’Adam, afin ainsi de libérer du péché d’Adam. C’est en effet à Adam qu’il avait été dit : à l’heure où vous mangerez, vous mourrez (Gn 2, 17), et c’est de cette mort dont il nous a libérés.
— La troisième cause fut que le Diable, qui est l’instigateur de la mort, avait assailli le Christ, lui qui ne l’avait pas mérité, et le Diable en a perdu son pouvoir sur les autres. C’est pourquoi il a conduit son âme à la mort, pour nous libérer de la nôtre.
Si l’on regarde maintenant les conditions dans lesquelles cette mort est survenue, criant d’une voix forte, il remit son esprit. Certains ont dit que la divinité était morte. Mais cela est faux, car la vie ne peut mourir, or Dieu est non seulement vivant, mais aussi la Vie. D’autres ont dit que l’âme était morte avec le corps. Mais cela ne peut être, car on ne peut perdre l’immortalité.
On notera aussi que tous meurent par nécessité. Mais le Christ est mort par sa propre volonté. De là vient qu’il est dit non pas qu’il est mort mais qu’il a remis [son esprit], car cela vint de sa volonté, ce qui indique son pouvoir comme il l’avait expliqué ailleurs : j’ai le pouvoir de déposer mon âme et j’ai le pouvoir de la reprendre (Jn 10, 18). Et il voulut mourir avec un grand cri, pour bien montrer que cela venait de son pouvoir et qu’il n’était pas mort par nécessité. Ainsi a-t-il déposé son âme comme il l’a voulu, et l’a-t-il reprise comme il l’a voulu. D’une certaine manière, il fut plus facile au Christ de déposer son âme et de la reprendre que pour quelqu’un de dormir et de se réveiller. Mais alors, pourquoi impute-t-on à d’autres sa mort ? C’est parce qu’ils ont fait ce qui leur revenait pour cela. »
L’effet des miracles (Mt 27, 54)
« En Luc, il est dit que l’effroi du centurion vint de ce que le Christ expira dans un grand cri. Mais ici il est dit que ce fut à la vue du tremblement de terre. Et Augustin dit que cette indécision ne serait pas facile à trancher s’il n’était ajouté et de ce qui s’était passé. Car cet homme symbolisait le peuple des gentils, qui ont confessé le Seigneur par une crainte salutaire. Ainsi Os 2, 25 : en ce jour-là… j’aimerai celle qu’on appelait Non-Aimée, et à celui qui s’appelait Pas-mon-peuple, je dirai : Tu es mon peuple ! et lui dira : mon Dieu ! De même Is 26, 18 : devant toi Seigneur nous avons conçu et nous avons enfanté un esprit de salut !
C’est alors que vient la vraie confession : vraiment celui-là était le Fils de Dieu. Et en cela se trouve repoussée l’hérésie d’Arius, qui ne reconnaissait pas au Fils existant dans le ciel d’être vraiment le Fils de Dieu, alors que le centurion, lui, l’a confessé dans la mort. 1Jn 5, 20 : Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l’intelligence pour que nous connaissions Celui qui est vrai. […] C’est lui qui est le Dieu vrai, et la vie éternelle. »
Conclusion
« Du fait que l’homme a été libéré par la passion du Christ il n’en est pas résulté seulement la libération du péché, mais bien d’autres avantages liés au salut :
1. Par elle, en effet, l’homme a appris combien Dieu l’aime et il est ainsi provoqué à l’aimer en retour ; c’est en cela que réside la perfection de son salut, et c’est pourquoi l’Apôtre dit aux Romains (5, 8.9) : Dieu nous a prouvé son amour en ce que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore ses ennemis.
2. Par elle il nous a donné un exemple d’obéissance, d’humilité, de constance, de justice et de toutes les autres vertus manifestées dans la passion du Christ et qui sont nécessaires au salut; d’où ce que dit la première épître de Pierre (2, 21) : Le Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces.
3. Par sa passion le Christ n’a pas seulement libéré l’homme du péché ; ainsi qu’on le dira plus loin, il lui a aussi mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude.
4. Par elle l’homme se sent poussé avec plus de nécessité à se garder pur de tout péché, selon ce verset de la première épître aux Corinthiens (6, 20) : Vous avez été achetés à grand prix; glorifiez donc Dieu et portez-le dans votre corps.
5. Cela a finalement tourné à une plus grande dignité de l’homme : de même que l’homme avait été trompé et vaincu par le diable, de même ce serait l’homme qui a son tour vaincrait le diable ; et de même que l’homme avait mérité la mort, de même l’homme vaincrait la mort par sa propre mort, selon ce que dit la première épître aux Corinthiens (15, 57) : Grâces soient à Dieu qui nous a donné la victoire par le Christ Jésus. » (Sum. theol., IIIa, q. 46, a. 3, resp.)
fr. Emmanuel Perrier, op
Les traductions sont nôtres, à l’exception de certains passages de la Somme de théologie, où elles sont empruntées à Jean-Pierre Torrell, Jésus le Christ chez saint Thomas d’Aquin, Cerf, 2008. Acheter chez La Procure, ou dans le volume de la Somme de théologie sur la Passion : Acheter chez La Procure.
-
Ce texte ne se trouve pas expressément en Is 22, 18, mais il résulte de son association avec Is 28, 5. La même association se retrouve dans une pièce chantée pour la Messe de la sainte Couronne d’épines : la couronne d’épreuves a fleuri en couronne de gloire (Corona tribulationis effloruit in coronam gloriae et sertum exsultationis). On doit remarquer que la sainte Couronne avait été reçue à Paris par saint Louis le 19 août 1239, soit trente ans avant que Thomas ne commente Matthieu dans la même ville. ↩