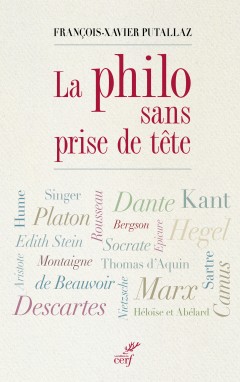Reprenant l’essentiel du texte de Montagne et Philosophie (Genève, Slatkine, 2012, 224 p.), l’A. veut contribuer par cette histoire de la philosophie à une « sagesse qui cultive l’équilibre » (p. 5). Pour cela, il présente avec simplicité, à peu près dans l’ordre chronologique, une galerie de philosophes. L’A. est en effet convaincu — contre Descartes (p. 149) — que le travail des générations passées aide au renouvellement actuel de la pensée. Certains des penseurs choisis sont ordinairement étudiés en littérature (Camus, chap. 17) mais ici traités pour leur philosophie ; Dante (p. 97, chap. 6) et Montaigne (p. 137, chap. 7) ont bien fait œuvre de philosophie morale. Rejetant le « psychologisme niais » qui réduit les penseurs à leurs sentiments, l’A. n’entend pas dissocier totalement « le jugement porté sur une doctrine et les éléments biographiques qui l’accompagnent » (p. 223). Il estime que le cœur et l’esprit se nourrissent mutuellement et qu’il existe — comme la durée de Bergson « constitue notre personnalité » ? (p. 242, chap. 14) — « une source unique qui alimente toute vie, toute pensée et toute œuvre » (p. 291).
Pour chaque pensée sont choisis un ou plusieurs thèmes importants — l’exhaustivité étant évidemment impossible. Les chapitres se complètent de sorte que les principales questions philosophiques sont abordées au fil du livre. Corrigeant au besoin certaines vues fausses couramment répandues dans l’histoire des doctrines (par exemple sur Rousseau, p. 179), le propos ne se limite pas à l’histoire des idées. Œuvre de philosophe, il juge des choses mêmes, et de la conformité des pensées au réel. On ne sera donc pas surpris de l’éloge de Socrate (p. 19, chap. 1), d’Aristote (chap. 3) ou de Kant (« penseur de race » malgré ses limites, p. 192, chap. 11) et plus encore de celui de saint Thomas d’Aquin (chap. 5) : sa philosophie originale et moins élitiste qu’Aristote, élaborée par et pour le théologien, n’est pas une servante servile ; ainsi la foi fait « mieux marcher sur la terre des hommes » (p. 87). Avec lui, la « rigueur technique » se fait « gardienne de la fraîcheur évangélique » (p. 90). Inversement, sont vivement critiqués l’utilitarisme (chap. 9), « seul passage triste de nos itinéraires » (p. 166) et qui ne mérite pas le nom de « philosophie » (p. 171), ainsi que Sartre à la « myopie insistante » (p. 278, chap. 16) dont les « combats outranciers » ne sont pas accidentels à une pensée de « l’auto-affirmation de soi » (p. 279). Chez les femmes, Edith Stein (chap. 15) montre plus de liberté qu’Héloïse se sacrifiant au goujat Abélard (chap. 4), plus de finesse et de constance que Simone de Beauvoir, dont il est à craindre que le jugement fût faussé par la vie déréglée (p. 285, comme pour Sartre p. 278, chap. 16).
Quelques thèmes parcourent l’ensemble. L’A. défend surtout la réalité et la notion de nature ainsi que la dignité de la personne humaine, insistant sur l’unité du corps et de l’esprit. Il s’oppose à l’euthanasie, meurtre ou suicide (cf. chap. 11 sur Kant). Il relève les limites des penseurs antiques, ignorant la misère de l’homme due au péché originel (p. 21 et p. 40), comme celles des modernes, révoltés dans l’impasse de leur refus de la création (p. 281) et de l’unique rédempteur des hommes (p. 297) : « La philosophie n’a jamais sauvé qui que ce soit » (p. 82).
Le 18e et dernier chapitre montre la consonance de la beauté et de la vérité, frappées aujourd’hui du même mal : le subjectivisme. La beauté est fondée dans les choses (p. 308). Elle procure la joie dans l’acte de connaissance de l’objet (p. 309). Elle mobilise la subjectivité et bouleverse qui y consent (p. 311). Certes, la beauté de ce monde est ambiguë, car on peut s’y arrêter, mais elle peut inviter à contempler sa source (p. 316). Tout le livre vise ainsi à montrer que « la vérité est aimable » (p. 303), en la présentant sous son meilleur jour. Aussi le style se veut-il plaisant, poétique même, généralement sans attenter à la clarté et à la précision de la pensée.
Relevons de rares erreurs typographiques : « vers [les] réalités » et « mo[n]de » (p. 35) ; mort d’Épicure en « [2]70 » av. J. C. (p. 323). Nous aurions évité l’emploi de l’expression « création continuée » (p. 249) et ses difficultés théologiques, ainsi que tempéré l’enthousiasme pour « l’assomption érotique de la chair » (p. 42) comme remède au platonisme.
Bien informé, l’ouvrage évite l’érudition mais offre à la fin, pour chaque chapitre, d’utiles indications bibliographiques et quelques conseils pour continuer l’étude. Espérons que ce livre sera une rampe de lancement pour de nombreux lycéens et étudiants, une agréable sente pour tout ami de la sagesse.
Fr. Bruno-Thomas Mercier des Rochettes, o.p.