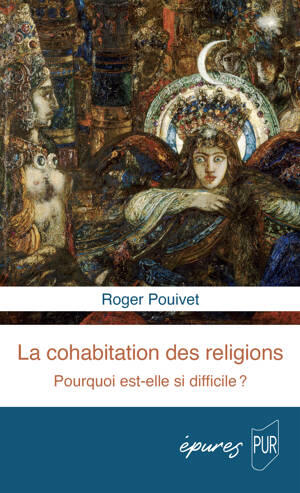La cohabitation des religions est le prolongement de deux livres qu’il n’est pas nécessaire d’avoir en mémoire, le présent ouvrage se suffit à lui-même, mais le lecteur gagnera à y revenir pour avoir une idée plus complète de la pensée de l’auteur sur la question de la vérité religieuse : Épistémologie des croyances religieuses, Paris, Cerf, 2013, et Qu’est-ce que croire ?, Paris, Vrin, 2002. Ce petit livre, clair et courageux, lucide et argumenté, explique en quoi il existe une vérité religieuse, et pas seulement des opinions ; que les désaccords qui les opposent sont comme la vérité par rapport à l’erreur et au faux. Le christianisme n’a pas le monopole de la vérité mais il est non seulement une vraie religion, mais la religion vraie. Les désaccords ne sont pas seulement des points de vue différents, de simples divergences mais des conceptions de Dieu et du rapport de l’homme à Dieu qui ne sont pas compatibles, qui sont éventuellement complémentaires. Les religions ne disent pas toutes la même chose, de manière différente ou au mieux convergente. Ce réductionnisme pluraliste facile est très en vogue jusque dans certaines instances de l’Église catholique, ou tout au moins il y trouve des complicités lénifiantes. Le pluralisme religieux est de fait, mais il n’est pas de droit. La religion et la vérité religieuse ne peuvent être réduites à des points de vue sur le fait religieux et son vécu, à des expériences ou à des différences pratiques. Il y a une révélation vraie et non plusieurs, ce qui est philosophiquement et théologiquement justifiable. Les schèmes du régime pluraliste, libéral et démocratique, de la culture contemporaine ne s’appliquent pas à la vérité religieuse, il y a une différence d’ordre ou de genre entre le « vivre ensemble » socio-politique et le « vivre ensemble » d’une religion révélée ou non révélée. La cohabitation des religions suppose un « vivre ensemble » que leur diversité implique en vertu de leurs principes religieux qui ne sont pas tous compatibles, sauf si les partenaires du dialogue interreligieux adoptent une attitude éthique concertée de respect dans l’échange et dans les désaccords, parfois radicaux entre eux. La vérité s’impose par elle-même, jamais pour une quelconque forme de contrainte mentale et culturelle. Pouivet, dans un premier chapitre, étudie la nature des croyances religieuses. C’est l’étude de la croyance et de ses formes qui explique ce qu’il appelle justement les inévitables désaccords entre les religions : « Le désaccord religieux » (p. 13-44). Dans un deuxième chapitre, il explique pourquoi le pluralisme religieux signifie qu’il ne peut y avoir plusieurs vérités religieuses compatibles en même temps à propos de Dieu, même si elles peuvent coexister existentiellement et socialement dans un même espace entre des personnes différentes et opposées : « La tentation du pluralisme » (p. 45-71). Enfin, dans un troisième chapitre, le plus long, il montre très exactement que non seulement il ne peut y avoir deux religions vraies en même temps mais que l’unique vérité n’est pas intolérante de soi. D’abord, parce que la notion de tolérance n’est pas le tout du « vivre ensemble ». La tolérance a, par elle-même, d’inévitables et nécessaires limites : tout n’est pas tolérable ; ensuite, les situations d’intolérance sont le résultat d’agents religieux qui agissent pour des raisons ou des motifs qui ne sont pas authentiquement religieux, pour des raisons ou des motifs idéologiques et politiques : « La vraie religion » (p. 73-116). La religion est chose sérieuse, elle traite de la vérité de la croyance en Dieu révélé, de salut, ce que la notion enveloppante, d’origine sociologique, de monothéisme ne doit pas dissimuler. La religion n’est pas seulement un fait humain, un fait social. Avant d’être une praxis, une orthopraxie, elle est une orthodoxie, il y est question de vérité : « La vérité n’est pas indifférente s’agissant de la religion ; elle n’est pas multiple ; elle n’est pas relative » (p. 11-12). Sous ce rapport, ou bien la doctrine catholique est vraie ou elle est fausse ; si elle est vraie, les autres religions qui prétendent dire aussi le vrai sont fausses, ce qui ne doit pas inquiéter, malgré le présupposé délétère et entretenu de la non-vérité. Se récrier en brandissant les guerres de religion est une esquive facile et indue. Pouivet rappelle les enjeux épistémologiques de la religion, à la fois comme accès à la vérité — dogmatique — de Dieu révélé, theoria, d’abord, et comme mode d’être et de vie, praxis, ensuite. C’est la « prétention » à la vérité qui est la norme de la légitimité des croyances (cf. p. 29-31), dans la mesure où les croyances sont fondées sur des raisons épistémiques, avant d’être des expériences ou de s’y résumer. Parler de Dieu ou de foi ou de religion en termes d’expérience n’est certes pas illégitime, mais non premier, la vérité en est la mesure fondamentale et incontournable. Il est donc capital de revenir à la critique de la connaissance religieuse, en amont de la simple certitude subjective et de l’expérience personnelle, reconsidérer l’idée, régulatrice en fait, de vérité et d’examiner ses fondements rationnels. En effet, les désaccords religieux sont rationnels et pas seulement sociaux ou pratiques. Le pluralisme religieux est un fait, mais l’inscrire dans une volonté divine pluraliste est une pétition de principe qui devrait être critiquée et élucidée plus à fond que ne le font de nombreux représentants religieux chrétiens contemporains. Les vécus religieux, aussi authentiques soient-ils — selon quels critères ? — ne sont pas régulateurs et discriminateurs de la vérité religieuse. Passer de la pluralité au pluralisme, du fait au droit, est contraire à la religion comme prétention légitime et rationnelle à la vérité. Il y a un ordre de vérités, et la vérité religieuse y a sa place, ce qu’il faut déterminer et juger. Les religions ne sont pas équivalentes ou égales ou compatibles. La sincérité d’une croyance n’en fait pas la légitimité épistémique et éthique. Ainsi, la cohabitation des religions n’est possible que sur le fond d’un désaccord insurmontable le plus souvent. La conversion et même le prosélytisme, entendu en son sens originel, n’ont rien de scandaleux. La vérité est un bien qui se communique. En revanche, les modes pratiques de coexistence et de cohabitation des religions doivent être évalués sur des critères rationnels, mesurés par le bien commun, et dans le respect de la vérité religieuse qui fait partie intégrante du bien commun, qui en est même la dimension supérieure. L’exclusivisme doctrinal n’est pas rationnellement aberrant. La religion relève, au-delà de la « production de sens » à quoi on la réduit, de la prétention universelle à la vérité, comme il en est dans bien d’autres domaines de la vie humaine : éthique et métaphysique. Qu’il y ait de l’arrogance chez tel ou tel représentant d’une religion est une chose moralement répréhensible, mais n’est pas un critère disqualifiant d’une religion en son contenu. L’humilité dans la vérité est le signe éthique que la vérité est un don et non un droit. L’humilité est la condition morale fondamentale de la tolérance pratique. La vérité est reçue, découverte, et non fabriquée ou constituée. L’exclusivisme doctrinal est la raison d’un exclusivisme sotériologique : hors du Christ, point de salut, et hors de l’Église du Christ, point de salut ; l’enchaînement est logique et épistémique, indépendamment de la sincérité des opinions et des appartenances qui ne peuvent être contraintes. Le relativisme est une erreur intellectuelle et morale. Précisons, ce que Pouivet ne souligne pas assez : que s’il y a des fausses religions, s’il y a des erreurs religieuses, on trouve aussi des vérités dans ces religions, disons des « éléments de vérité », comme dit le concile Vatican II, enchâssés il est vrai dans des erreurs. Toute religion non chrétienne n’est pas un amas de faussetés. C’est parce qu’il y a d’authentiques « éléments de vérité » qu’il est possible de pratiquer, sans faux-semblant, qu’il est possible de justifier, rationnellement, ce qu’on appelle le dialogue interreligieux, pas simplement au plan pratique mais théorique. Roger Pouivet nous donne un livre épistémologiquement utile, roboratif pour l’intelligence, que l’on soit philosophe, théologien, ou même acteur de la vie politique et sociale.
fr. Philippe-Marie Margelidon, o.p.