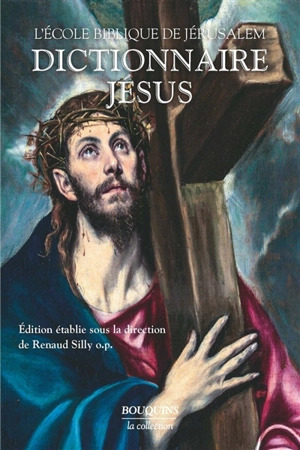Nous publions ici un entretien avec fr. Etienne Harant sur le tatouage, pratique ancienne[1] mais aujourd’hui populaire[2], ainsi que sur ses enjeux anthropologiques et moraux. Il s’agit d’ouvrir, par ce texte, une réflexion proprement chrétienne sur ce sujet délicat et d’apporter quelques éléments de discernement.
La rédaction : Une première question, très simple, mais fondamentale : la Bible parle-t-elle du tatouage ?
fr. Etienne Harant : On trouve dans le livre du Lévitique cette prescription : « Pour un mort, vous ne vous ferez pas d’incisions sur le corps. Vous ne vous ferez pas faire de tatouage[3]. Je suis le Seigneur. » (Lv 19.28)
L’interdiction semble claire. Les fils d’Israël ne doivent pas se faire de marques sur le corps, car ce corps ne leur appartient pas, mais il est à Dieu[4].
Il faut noter cependant que la remarque prend place dans un ensemble de pratiques païennes, et les lois mosaïques visent en priorité à distinguer le peuple hébreu de ses voisins. C’est donc notamment dans cette logique de distinction civile et religieuse que le tatouage semble interdit. Ils sont le peuple qu’Adonaï s’est choisi, et aucune autre appartenance ne doit venir remettre en question ce choix divin. Ils sont le peuple qu’Adonaï s’est choisi, et aucune autre marque d’appartenance ne doit venir remettre en question ce choix divin.
Pour cette raison contextuelle, pensez-vous que cette prescription biblique serait abolie et que le tatouage serait autorisé ?
Cette interdiction pourrait être, en effet, interprétée comme faisant partie des prescriptions qui ont été abolies par le sacrifice du Christ. Si nous étions encore tenus aux prescriptions du Lévitique, nous ferions des entorses bien plus graves à la Loi de Moïse en dégustant un plateau de fruits de mer, ou un barbecue, plutôt que de nous marquer la peau…
Y a-t-il d’autres versets bibliques qui évoquent de près ou de loin le tatouage ?
Le sujet du tatouage ne semble pas clos au livre du Lévitique et diverses mentions de « marquages » peuvent attirer notre attention. Le prophète Isaïe fait allusion à une écriture sur la main : « Un autre encore écrira sur sa main[5] : « Je suis au Seigneur ! » et il prendra le nom d’Israël » (Is 44.5). La pratique du tatouage étant déjà connue dans la lointaine antiquité, ce verset peut très bien se comprendre au sens littéral de mots insérés sous la peau avec de l’encre.
Un passage de l’épître aux Galates pose aussi question. En effet, S. Paul y fait mention de « marques » des souffrances du Christ qu’il aurait reçues[6]. S. Paul emploie le terme de στίγματα (stigmata) qui a donné en français celui de « stigmates ». Mais en grec, il signifie aussi une marque faite au fer ou à l’encre qui signifie une appartenance, comme par exemple pour les légionnaires ou les esclaves. Là encore, une interprétation littérale allant dans le sens du tatouage ne semble pas pouvoir être écartée a priori.
L’Écriture sainte suggère donc que le tatouage n’est pas un acte banal. Quelles ont été les conséquences de cette affirmation dans l’histoire de l’Église ?
En effet, être tatoué d’une représentation de quelque chose ou de quelqu’un, c’est avoir ce quelque chose ou ce quelqu’un dans la peau, et ce qui marque la peau prend possession de cette peau de quelque manière. À qui la peau tatouée appartient-elle ? Au tatoué que sa peau contient, ou bien à celui dont la marque s’y trouve gravée ? La même attitude se retrouve au cours de l’histoire de l’Église, dans les règles qui ont cherché à discipliner la pratique des tatouages chez les chrétiens. Le contexte culturel jouait alors un rôle important pour faire pencher la balance du côté de l’éloge (par exemple dans la vénération pour les stigmatisés, comme récemment le Padre Pio) ou du côté du blâme. Ainsi nous sommes issus de la culture gréco-latine, qui a façonné une conception d’un corps parfait absent de marques (cicatrices, tatouages, ou piercing), à la différence des barbares qui pratiquaient abondamment cela[7]. L’Église, en évangélisant ces peuples, a cherché à instaurer de nouvelles pratiques qui mettaient à l’abri d’un retour au paganisme. Ceci pourrait expliquer une certaine méfiance à l’égard du tatouage largement pratiqué dans la grande majorité des peuples tant d’Europe du Nord que d’Orient, avec souvent un caractère religieux. En plus de la signification à caractère païen, cette pratique pose des questions théologiques, notamment dans le rapport au corps.
Le tatouage est donc l’indice d’une quête d’identité. Que penser du geste même de marquer sa chair ? Que dit-il du rapport à soi ?
Le geste d’insérer de l’encre sous la peau est chargé de sens. On peut certes en manquer la portée sur le moment. Ainsi le coup de tête d’une soirée un peu arrosée, ou la seule envie de se faire reproduire le même tatouage que sa vedette préférée reportent la prise de conscience à plus tard. Mais qu’on y réfléchisse avant ou après, le tatouage ne marque pas que la peau.
Se marquer la peau avec un signe, un mot ou une phrase est d’abord une recherche de réappropriation du corps. « La marque corporelle est souvent une prise d'autonomie, une manière symbolique de prendre possession de soi »[8]. Le tatouage serait une manière de signifier, d’abord à soi-même puis aux autres, le lien que nous entretenons avec notre propre corps. Parmi les exemples que donne D. Le Breton, dans son livre Signes d’identité, je voudrais citer l’exemple de L. D. Elle raconte qu’après chacune de ses grossesses, elle a éprouvé le besoin de resignifier à elle-même ce lien avec son corps, après avoir comme « perdu » une partie d’elle-même dans l’accouchement. Ou encore M. P., exposant sur son bras une main de chair serrant une main de squelette avec l’inscription « memento mori », explique qu’elle a fait cela après une tentative de suicide. Le tatouage est pour elle une manière de ne jamais oublier la fragilité de sa propre existence. Ainsi ces marques prennent place dans l’histoire personnelle de la personne. Le tatouage fait aussi régulièrement partie d’un processus de deuil, c’est une manière de laisser partir la personne sans l’oublier, une manière de la fixer. Le tatouage aurait donc des vertus « thérapeutiques » : « le signe cutané est une manière d'apaiser la turbulence du passage d'un statut à un autre, de donner une prise symbolique sur l'événement, et de ritualiser ainsi le changement »[9].
Cette pratique cherche aussi à manifester une individualité. « Le corps, lieu de souveraineté du sujet, est la matière première de son rapport au monde. »[10] Même si, pour l’essentiel des personnes interrogées sur le sujet, ce tatouage semble d’abord fait pour eux-mêmes, sa dimension visible pour autrui est aussi indéniable. Ainsi, un signe sur la peau marque mon unicité.
Les tatouages ont une dimension esthétique, ornementale. Les lettres, par exemple, sont calligraphiées, les dessins et les motifs, parfois extraordinairement travaillés.
La dimension esthétique joue pour beaucoup, en effet, dans la pratique du tatouage. C’est une affaire de goût certes, mais il apparaît clair que cette pratique a engendré une forme d’art qui a ses propres canons et ses genres, et qui compte déjà plusieurs maîtres reconnus.
D’un point de vue anatomique, l’injection d’encre sous le derme n’est pas vraiment une modification corporelle, comme pourrait l’être une scarification ou une ablation. Ce serait plutôt une sorte de maquillage, mais indélébile (ce qui en fait une différence essentielle). C’est d’ailleurs son caractère de permanence qui lui donne en partie sa signification si lourde. Dans le choix de marquer sa peau, il y a tout de même cette volonté de rendre son corps plus beau. De se l’approprier certes, mais par de la beauté. Une certaine aversion naturelle pour cette pratique fait peut-être passer à côté de la réelle valeur esthétique de certaines pièces. Cependant, tant la technique de réalisation que la symbolique qu’elle utilise, peuvent susciter l’admiration et le respect.
D’un point de vue anthropologique, c’est surtout la notion d’appartenance liée au tatouage qui interroge. Cela n’explique-t-il pas son succès aujourd’hui dans une société fluide et éclatée ?
Le marquage de la peau servait avant tout de signe de reconnaissance. Par exemple, les tribus maoris (d’où le mot tatoo est issus d’ailleurs) utilisaient cette pratique comme un mode de communication. En rencontrant un individu, à ses seuls tatouages, il était possible de connaître sa tribu, sa parenté, et même sa fonction au sein de son village. À l’heure actuelle, le choix d’un tatouage répond très rarement à ce sentiment d’appartenance traditionnel et non choisi, et le sens même du symbole inscrit est donné par celui qui l’arbore, en dépit parfois de son sens traditionnel. « Le monde contemporain témoigne du déracinement des anciennes matrices de sens. »[11] Et dans ce monde sans héritage, le tatouage répond à une soif de se rattacher à quelque chose, même si c’est partiellement le fruit d’une imagination. Si le tatouage exhibe une appartenance, elle semble construite par la personne tatouée, plutôt que reçue comme héritage culturel. Cette exacerbation d’individualisme marque en même temps une profonde détresse face à une absence relative d’héritage commun. Alors on invente cet héritage, on se découvre passionné de mythes scandinaves ou égyptiens, de telle angélologie perse, du rite maori ou aztèque. En ce sens, le paganisme semble faire un retour en force par le biais du tatouage. Comme D. S., suivant les exemples de David Le Breton, qui a tatoué sur tout son corps des scènes de la mythologie scandinave alors qu’il vient du canton de Fribourg (Suisse). Il dit trouver dans ces histoires de quoi comprendre sa propre existence et poser des choix éclairés par ces représentations.
Notre corps apparaît, dans l’époque hyper-technologique et virtuelle qui est la nôtre, comme ce qui nous rattache, au fond, à la nature. Le tatouage consacre-t-il le divorce de l’âme et du corps, ou signe-t-il un essai de réconciliation et de retrouvailles ?
Le premier constat que l’on peut faire, c’est que la conception de l’âme comme principe informant et donnant vie au corps n’est plus partagée par l’ensemble de nos contemporains. La révolution sexuelle se veut être l’ultime séparation de l’âme du corps. « Je fais ce que je veux de mon corps, qui n’est que mécanique, cela n’a aucune incidence sur mon identité » (peu importe d’ailleurs le sens que ce mot prend). Cependant, le tatouage vise selon moi strictement l’inverse, il cherche à mettre à fleur de peau ce qui est le plus intime (une pensée, une représentation de soi-même, un évènement marquant…). La pratique du tatouage, par le truchement du symbole, tente de rendre visible l’âme immatérielle qui informe notre corps. « Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau », disait Paul Valéry[12]. Preuve en est que les personnes tatouées ne sont pas toujours disposées à parler de leurs tatouages, arguant un caractère trop intime. Là encore, cette pratique à l’encre cherche peut-être à recréer ce lien dissolu entre le corps et l’esprit, entre mon corps et mon esprit. Il peut être perçu comme cicatrice sur la peau, mais qui vient de l’intérieur, une marque de l’esprit sur le corps. Ce tatouage pourrait être une tentative contemporaine de réappropriation de soi à une époque où tout vise à nous disloquer en parcelles mesurables en vue d’une optimisation. Et son caractère indélébile marque l’engagement total de la personne qui le reçoit. Ce signe sera pour toujours visible sur sa peau et ainsi il dit quelque chose d’immuable (souhaité ou imaginé comme tel au moment de l’acte) de la personne.
D’un autre côté, cette pratique peut se révéler être une sorte d’appropriation totale et démesurée de son corps, qui serait le résultat d’une auto-subjectivité exacerbée. Cette subjectivité trouverait également un écho dans la pratique religieuse. Le tatouage ayant une longue histoire et s’inscrivant bien souvent dans des rites religieux païens, la recrudescence de sa pratique serait partiellement assimilable à une forme de néopaganisme, pratiqué par des « néo-primitifs »[13] sur fond de « religion personnelle », qui serait le fruit d’un monde sans repère qui chercherait du sens dans un antique passé révolu, avant toute influence chrétienne.
Revenons aux enjeux théologiques. Nous savons que le tatouage s’est parfois pratiqué chez les chrétiens en Orient, ce qui semble montrer qu’une évangélisation de cette pratique est possible. Comment envisager cette christianisation ?
Le premier facteur à prendre en compte est le désir de signifier sa dévotion. Il s’agit de faire entrer sous sa peau son appartenance au Christ. Suivant les exemples de David Le Breton, pour T. R. qui arbore un magnifique crucifix sur le torse, cela est clair : « il est mort pour moi et je ne veux jamais l’oublier, l’avoir sous les yeux tous les jours », et sur le mur cela ne semblait pas suffire, il le fallait sur lui ! M.C. dit la même chose, avec son discret « M » entrelacé d’une croix, modèle de la médaille miraculeuse sur l’avant-bras, « en baissant les yeux, je voulais penser à Marie. » Ces marques seraient donc d’abord des « rappels dévotionnels », des stimuli pour la prière, afin de ne jamais perdre de vue celui qu’on aime plus que tout.
Se tatouer un symbole religieux chrétien, c’est manifester sa pleine appartenance au Christ, comme un légionnaire appartient à l’Empire. L’aspect indélébile du tatouage se veut être une garantie de fidélité à cette pleine appartenance, comme un gardien face à l’apostasie. M. C. le fait remarquer : en faisant son tatouage, elle voulait aussi marquer un pas décisif dans sa foi. « Je ne pourrai plus faire marche arrière » dit-elle. C’est l’une des raisons pour lesquelles les coptes se tatouent une croix sur le poignet, pour se garder de toute apostasie dans un pays sous domination musulmane. Dans une société en processus d’apostasie générale, vouloir se protéger de ce mal n’est pas absurde. Et le moyen choisi dans le tatouage a en plus le bon goût d’être esthétique…
Précisons qu’une condition essentielle doit être remplie à ce sujet : le tatouage « dévotionnel » doit être effectivement beau. Ainsi, il ne doit pas chercher à dévaloriser le corps (œuvre de Dieu) mais bien à l’embellir par une beauté conforme à la beauté finale de l’homme dans la béatitude[14]. Le symbole représenté se doit de rendre manifeste cette finalité du corps (le Christ, la Croix, un ange, un saint, …), et non une haine de son propre corps, un motif de péché, ou l’entretien d’un vice. Nous pourrons y revenir.
M. ajoute même, qu’à présent il est comme obligé de parler de sa foi, de témoigner. Un tatouage engage plus qu’une croix autour du cou et interpelle plus radicalement. En effet, il a fallu accepter de passer sous l’aiguille, et cela questionne : en vue de quoi choisir une telle douleur ? T. M. fait remarquer que c’est un outil d’évangélisation et que son tatouage donne lieu à de vraies conversations.
Le souvenir de moments de grâces, d’instants de rencontres tout particulier avec le Dieu vivant, peut également faire l’objet d’un marquage à l’encre sous la peau. Les pèlerinages sont des moments opportuns pour cette pratique. M. d. C. ayant effectué un pèlerinage en Terre Sainte, qui fût une étape marquante dans sa vie spirituelle, en est revenue avec la croix de Jérusalem sur l’avant-bras (le motif désormais classique chez les catholiques). Elle ajoute: « je ne voulais pas inventer un motif, mais prendre quelque chose de traditionnel ». De fait, elle a fait son choix parmi les tampons en bronze de la célèbre Maison Razul dans le souk de Jérusalem, tatoueur chrétien depuis plusieurs générations.
Dans cette perspective, est-ce que la douleur liée au marquage peut prendre un nouveau sens ?
En effet. Dans cette pratique quasi dévotionnelle de marquer sa peau au nom du Christ, la dimension de la douleur prend un sens renouvelé. Dans le cas du tatouage en phase de deuil, la douleur peut jouer un rôle de catharsis, c’est-à-dire de purification de l’esprit. Il faut cependant ajouter à cela les principes spécifiquement chrétiens que nous avons soulignés, à savoir que la symbolique et ce qui est tatoué soient conformes à l’espérance chrétienne.
Dans le cas d’un tatouage chrétien, cette douleur fait partie du processus, comme une union à la Croix du Christ. T. M. explique que ce crucifix sur son torse représente le sacrifice du Christ pour lui, et que l’aiguille sous sa peau lui a donné une petite occasion d’offrir ces souffrances en union avec celles de la Croix[15]. Cet aspect moral est l’un des critères de discernement de la justesse de cette pratique.
Toutes ces remarques nous permettent de mettre en lumière à la fois l’intention de l’acte de se tatouer, et ses conséquences. L’une comme l’autre peuvent avoir des motifs bons (dévotions, souvenir, évangélisation, …). Nous avons par ailleurs déjà établi que l’acte lui-même du tatouage peut trouver des motifs bons, dans la mesure où il n’est pas une mutilation ou une dégradation du corps, qui serait contraire à l’amour de soi.
Vous avez souligné l’enjeu anthropologique du tatouage. Comment l’anthropologie chrétienne peut-elle éclairer cette pratique ?
L’anthropologie chrétienne professe l’union hylémorphique de l’âme et du corps. L’âme est la forme substantielle du corps[16]. Elle l’anime. Ainsi « l'âme n'est pas faite pour le corps, mais c'est l’inverse : le corps est fait pour le bien de l'âme ».[17] Seulement ce principe immatériel, pourtant présent partout dans le corps du fait de cette union substantielle, peut nous paraitre parfois un peu vague. La pratique du tatouage, par le truchement du symbole, tente de rendre visible cette réalité immatérielle. En ce sens, le tatouage entre dans le cadre de l’œuvre d’art, qui tente de dire par la matière (pierre, bois, pigment, toile, et ici encre et peau) une réalité en soi immatérielle.
Cette manifestation à la surface de son être de ce qui peut se trouver au plus intime, en son cœur même, vise à fortifier cette unité, à l’expérimenter en sa chair. Un religieux qui avait voulu se faire tatouer la croix de Jérusalem pendant un pèlerinage, témoignait que cela lui semblait être une manière d’inscrire dans sa chair sa profession religieuse, une sorte d’incarnation du don de sa vie. À une époque de dématérialisation croissante, de déni du corps en sa faiblesse et de son lien substantiel avec l’âme, est-ce étonnant de voir surgir en réaction de telles affirmations d’incarnation ?
Des critères moraux semblent donc nécessaires. L’exigence de beauté en fait-elle partie ?
L’acte de se marquer la peau, est souvent perçu comme une modification de son corps et donc conçu comme mauvais. Dieu nous a donné un corps tel qu’il est, alors pourquoi le modifier ? L’argument ne manque pas d’une certaine sagesse, mais il pose plus largement la question de la cosmétique et des bijoux…Une paire de perles aux oreilles ne cherche-t-elle pas à rendre plus belle la silhouette d’un visage ? La Création est une œuvre bonne, à laquelle nous sommes appelés à participer. Ajouter à son corps une marque qui nous rappelle le Créateur ne semble pas pouvoir être qualifié de mauvais en soi. Néanmoins, le tatouage ne peut pas être mis sur le même plan qu’un simple ornement car il est permanent.
La permanence du tatouage joue un rôle déterminant dans sa qualification morale. Le choix de marquer sa peau de manière indélébile rend explicite le rapport entretenu avec le corps et sa finalité. Ce rapport peut être bon ou mauvais. Ce lien entre chair et esprit que semble renforcer cette marque sur la peau est aussi une expression de la perception de soi-même et de son rapport aux autres, et in fine à Dieu.
Finalement, quels critères moraux peut-on donner pour juger de la bonté d’un tatouage ?
Pour qu’un acte soit jugé bon en théologie morale, il faut qu’à la fois l’intention, l’acte lui-même et ses conséquences le soient. Or, les analyses ci-dessus montrent qu’il est possible dans le cas du tatouage de montrer une réelle bonté dans toutes les dimensions de l’acte en question. Si le tatouage vise à renforcer l’unité de mon être en vue du service de Dieu, il ne semble pas qu’il y ait dans un tel acte un mal intrinsèque. En revanche, le tatouage peut s’avérer être un acte moralement mauvais dans la mesure où il servirait à nier toute origine et appartenance divine du corps, au profit d’une simple recherche de réalisation de soi par une appartenance à une pseudo-communauté. Ainsi, il serait mauvais dans la mesure où il procèderait d’une haine de soi ou de Dieu, où il mutilerait le corps ou le dégraderait, par le choix d’un motif inconvenant, malsain ou tout simplement insignifiant.
En revanche, pour qu’un tatouage soit jugé moralement bon, il devra signifier, notamment par sa beauté, l’appartenance à Dieu dans toutes les dimensions de la personne. L’intention à elle seule ne suffit pas, cet aspect subjectif de l’acte devra être cohérent avec le choix du motif représenté. La signification des symboles ne sont pas qu’arbitraires et ne dépendent pas uniquement de la subjectivité de chacun. Certains mots, signes, noms, formes et assemblages ont une histoire qu’il serait présomptueux de négliger dans un acte aussi lourd de sens. Le tatouage se devra donc d’être un embellissement du corps au service de la manifestation de la gloire de Dieu.
Pour terminer, quels enseignements pouvons-nous tirer de la recrudescence du phénomène du tatouage ?
La dimension symbolique du tatouage, en plus de sa pratique très répandue, en fait un sujet d’étude réel pour l’anthropologie chrétienne. Il semble répondre à bon nombre d’aspirations de nos contemporains en faisant appel à des pratiques ancrées (ou encrées ?) dans l’humanité depuis la nuit des temps. Le progrès ne semble pas aussi linéaire qu’une certaine philosophie voudrait nous le faire penser. Est-ce pour autant un simple « retour » que nous observons ? Nous ne sommes plus dans une ère pré-chrétienne, mais bien post-chrétienne. En ce sens les relations avec la société ne sont plus pensables dans le même cadre. Cette large pratique du tatouage semble trouver un écho et un sens dans un contexte religieux chez les disciples du Christ. Il semble même être une réponse dévotionnelle contemporaine. Ces pratiques changent et sont à l’image du temps et des mœurs où l’Evangile est proclamé.
Fr. Etienne Harant, o.p.
Tous les articles
[1] Des archéologues ont exhumé des momies tatouées datant de 5200 ans avant JC. Cette pratique semble universelle puisque de telles découvertes ont été réalisées sur les cinq continents.
[2] Un sondage Ifop datant de 2017 indique que 14% des français sont tatoués et 27% des moins de 35 ans (cf. Les Français et le tatouage - IFOP).
[3] Le nom commun employé ici dans les textes tant hébreux que grec, est un hapax. On ne trouve ce mot qu’une seule fois dans toute la Bible. Ainsi le contexte (un marquage dans la chair) nous permet de traduire par « tatouage » mais aucune autre occurrence ne permet de comparaisons lexicales.
[4] On retrouvera cette conviction chez Saint Paul. Par exemple : « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ; or Dieu fera disparaître et ceux-ci et celui-là. Le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps” (I Co 6.13)
[5] Ce « marquage » des élus se retrouve à plusieurs reprises de la Genèse à l’Apocalypse (par ex : Gn 4.15 ; Ex 13.16 ; Ez 9.3 ; Ap 7.2 et Ap 22.4) et plusieurs Pères de l’Eglise y ont vu une préfiguration du caractère baptismal imprimé dans l’âme. C’est souvent le terme de σφραγίς (sceau) qui est employé pour désigner le résultat de ce marquage. Ce terme renvoi à l’idée d’un signe apposé qui est indélébile.
[6] Cf. Ga 6.17.
[7] « Le stigmate corporel symbolisait l'aliénation à l'autre dans la société grecque antique, aujourd'hui, à l'inverse, la marque corporelle affiche l'appartenance à soi » Le Breton David, Signes d’identité, A.m. Metailie, Paris, 2002, p. 20. De plus, certains peuples aux limites de l’Empire Romain ont même été nommés par le fait qu’ils étaient « marqués » : lesPictes.
[8] Le Breton David, Signes d’identité, Metailié, Paris, 2002, p. 11.
[9] Le Breton David, Signes d’identité, p. 15.
[10] Le Breton David, Signes d’identité, p. 16. Dans une vision d’anthropologie chrétienne, considérer le corps comme simple matière modifiable, n’est pas concevable. La fin de l'entretien présentera plus en détails la pensée chrétienne concernant la relation au corps et l’incidence de le marquer de manière irréversible.
[11] Le Breton David, Signes d’identité, 2002, p. 15.
[12] Valéry Paul, L’Idée Fixe, Gallimard, 1933.
[13] Cf. Le Breton David, Signes d’identité, p. 125.
[14] Les stigmates du Christ après sa résurrection sont un bon point de repère pour cette question. Ces marques sont un signe de la gloire du ressuscité. Saint Thomas d'Aquin, Somme de théologie, IIIa, q. 54, a. 4, ad 1 : « Les cicatrices demeurées sur le corps du Christ n’impliquent ni corruption ni déficience, elles signifient plutôt un comble de gloire, car elles sont le signe de sa vertu et une beauté spéciale apparaîtra à leur emplacement. »
[15] Nous mentionnons, sans pouvoir le traiter ici, la possible dépendance que crée la pratique du tatouage. L’expérience montre que les personnes tatouées se limitent rarement à une seule expérience. Le cocktail endocrinologique sécrété lors d’une séance de tatouage semble y être pour beaucoup.
[16] Cf. Saint Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia, q. 76, a. 1.
[17] Putallaz François Xavier, L'âme humaine, Ia q. 75-83, Cerf, Paris 2018, p. 653.