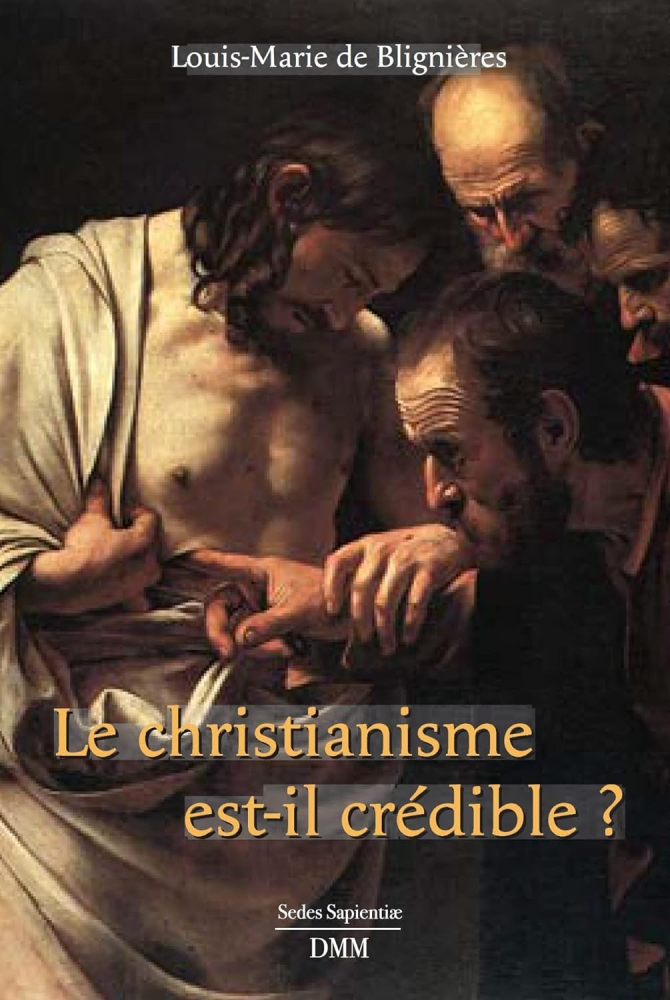En répondant aux « principales objections argumentées » (p. 13) contre la foi chrétienne, l’A. présente avec ordre et continuité les principaux motifs de crédibilité du christianisme. Il n’entend pas traiter de la défense de la religion en général ou de l’Église du Christ en particulier. Il expose ce que devrait reconnaître « l’agnostique honnête » ou « le chercheur de bonne foi » (p. 133). Quoi qu’il en soit de son efficacité missionnaire, l’apologétique fortifie la foi des chrétiens en écartant les objections. « Sans complexe » (p. 11), elle s’oppose au fidéisme comme à l’a priori scientiste ou historiciste. Elle évite rationalisme et prosélytisme, l’acte de foi restant fruit de grâce et de liberté. L’apologétique offre une certitude morale et non mathématique. La perspective est thomiste. Le propos est généralement fluide, quelquefois technique. Le premier chapitre soutient les suivants en montrant la valeur historique du Nouveau Testament (à la différence des apocryphes). La transmission manuscrite est fidèle. Quant aux auteurs : « Personne ne ment gratuitement » (p. 37). Le Christ réalise les prophéties de l’Ancien Testament (chap. 2) non seulement en de nombreux détails mais « selon une synthèse supérieure » (p. 67) et originale des thèmes messianiques, les interprétations contemporaines concurrentes demeurant inaccomplies. Les miracles (chap. 3) sont pour la doctrine qu’ils attestent une « preuve indirecte par un signe certain » (p. 101). Le Christ a bien enseigné une doctrine, excellente et sublime (chap. 4). Il présente dans sa personne la « norme vivante de sa propre parole » (p. 130). La résurrection du Christ (chap. 5) est certes un mystère à croire mais, prédite et attestée, elle fait l’originalité du christianisme qui seul promet un salut total. Enfin, Jésus affirme sa divinité et sa filiation divine (chap. 6). Or, sage et saint, il ne saurait être trompé ni trompeur. Il se montre parfait témoin par sa compétence et sa véracité : il « conduit à sa doctrine par sa personne » (p. 198) ; d’où sa place centrale en apologétique. Le témoignage appartient au « régime humain de la raison, qui est essentiellement social en même temps que personnel » (p. 194). Cependant, la réponse à la question de l’identité du Christ exige un passage de la crédibilité à la foi dans une « continuité concrète » (p. 198) enracinée dans l’unité de la Personne du Christ, subsistant en deux natures.
Relevons quelques menus défauts. L’apologétique, brièvement défendue en introduction, est comprise comme cette « partie spécifique de la théologie sacrée » étudiant « la religion révélée sous la raison de sa crédibilité » (p. 11). Ne conviendrait-il pas plutôt de la désigner comme partie intégrante de cette science une qu’est la théologie (Sum. theol., Ia, q. 1 a. 3) ? Les manuscrits de la Guerre des Gaules sont indiqués datés « d’au moins 900 ans » (n. 7, p. 16) puis de « 1 000 ans » (p. 17). Saint Ignace est nommé à tort « disciple » de saint Polycarpe. Il aurait fallu mieux distinguer les Pères apostoliques, qui ont connu « des disciples directs des apôtres » (p. 23), des apologètes cités dans la foulée comme Tertullien, Origène et Clément (p. 26-27), et parmi lesquels on compte généralement saint Irénée (p. 25 et p. 184) bien qu’il ait connu saint Polycarpe, disciple de saint Jean. Le fragment de Muratori est indiqué comme datant avec certitude autour de 107 (p. 25), sans référence, alors que ce texte fait mention d’œuvres plus tardives du IIe siècle.
fr. Bruno-Thomas Mercier des Rochettes, o.p.