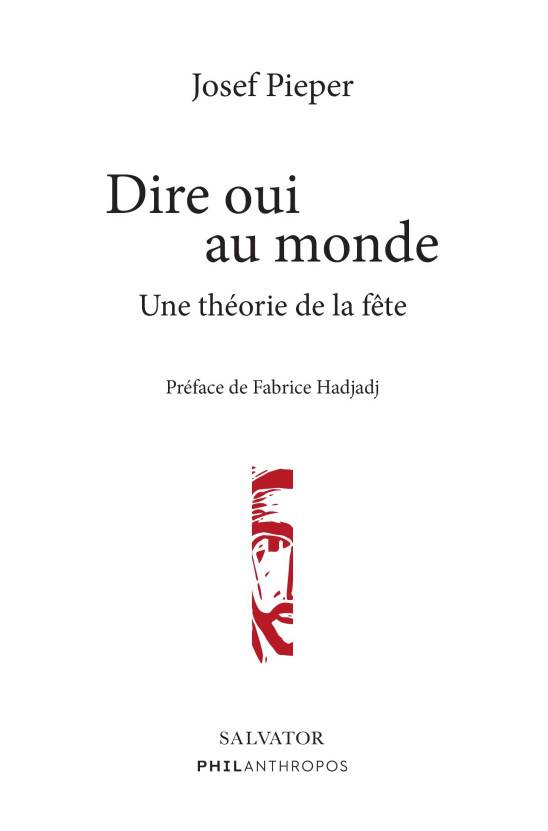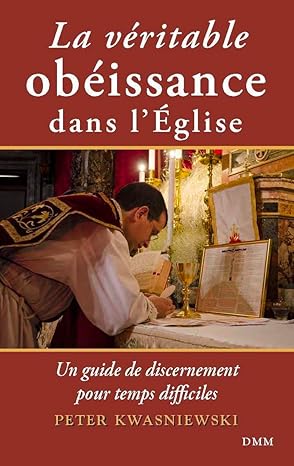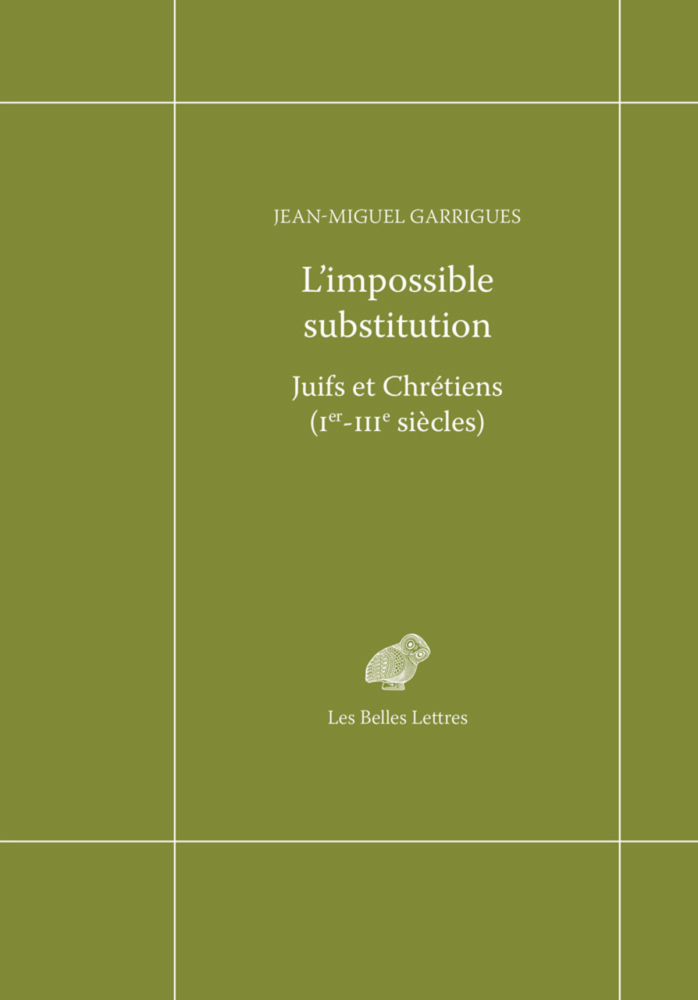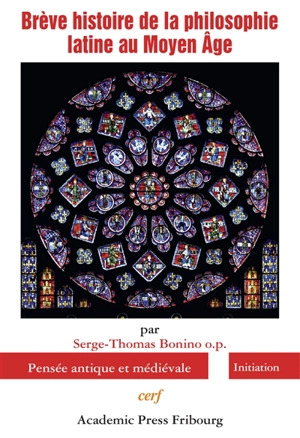« La fête est en voie d’extinction... » Voilà le constat que Joseph Pieper (1904-1997) faisait en 1963, quarante ans avant que Philippe Muray (1945-2006) ne décrive homo festivus puis homo festivus festivus, « le dernier homme » en Occident[1] . Les deux auteurs dénoncent les « pseudo-fêtes » mais Pieper s’efforce d’exorciser le mal en cherchant le sens des fêtes véritables et ce qu’elles préfigurent. Pieper croit encore à la fête et il l’espère. Trois points principaux ressortent de cet essai qu’il dédie à son frère : le lien entre travail et fête (1), le consentement à l’être et au cosmos (2), l’ordre à Dieu dans le culte juste et bon que l'homme lui rend (3).
I. La fête comme « pause respiratoire »
C’est par l’angle du temps que Pieper aborde le thème de la fête. Le jour de fête ne se distingue-t-il pas du jour du travail ? « Le travail relève du quotidien tandis que la fête est quelque chose d’inusuel — une interruption dans le cours ordinaire du temps[2]. » Mais le temps de la fête n’est pas toujours un temps bref ou un temps qui cesse. La béatitude, en Paradis, sera une fête continue, éternelle. Mais sur terre, « dans l’existence de l’homme concret », « la saillie festive du jour de fête n’est rendue possible que par l’exception[3] ». Pieper rappelle que la fête est « une pause respiratoire », une « halte[4] » instituée par les dieux. L'homme est momentanément déchargé par les dieux des contraintes qui pèsent sur son existence. Pieper n'oppose pas travail et fête : « Il n’y a donc pas de fête — sinon dans une vie dont la forme habituelle est le travail[5]. » Un vrai travail appelle et rend possible une vraie fête. À l’inverse, les « pseudo-fêtes » manifestent un « pseudo-travail[6] » : « Une classe d’oisifs ou de fainéants peut bien se goberger dans le luxe, elle n’arrive guère à s’amuser vraiment et encore moins à célébrer une fête[7]. » Comment discerner ce qui est un vrai travail ? Pieper, malheureusement, ne développe pas ce point, du moins dans cet essai[8]. Il se contente de dire que le véritable labeur se reconnaît au fait qu’« il amène à la fois bonheur et fatigue, satisfaction et sueur au front, joie et déperdition de force vitale. Omet-on l’un des deux, que la réalité du travail s’en trouve falsifiée, et la fête devient impossible[9] ». La conviction de Pieper est que « seul un travail sensé constitue le terreau fertile où peut germer un jour de fête. Il est donc probable que les deux, travailler et fêter, vivent de la même racine : lorsque l’un meurt, l’autre se dessèche[10]. »
II. La fête comme oui au monde
Le refus d’opposer travail et fête constitue la première ligne de force de cet essai. La deuxième est inspirée par une remarque Nietzsche dans les Carnets des années 1875-1879 : « le tour de force n’est pas d’organiser une fête, mais de trouver des gens capables de s’en réjouir. » Pieper admire le caractère prophétique de la formule, qui annonce que « la fête est en voie d’extinction » mais qui en donne aussi la raison : « l’organisationnel à lui seul ne suffit pas à produire le festif [11]». Pieper n’est pas décliniste. Il sait que toutes les époques ont eu du mal à faire la fête mais il voit comme « une particularité de notre temps d’avoir expressément répudié la fête[12] ». Ce drame vient de la montée en puissance de l’organisationnel, du fonctionnalisme, du technologisme. Or « le concept de fête est impensable sans un élément de contemplation[13] ». Ce qu’il manque aux pseudo-fêtes, c’est « une écoute et donc une considération silencieuse de l’existence en son fondement[14] ». La fête est une activité au plus haut point métaphysique puisqu’elle touche à la considération de l'être.
Cette contemplation suppose un renoncement pratique aux affaires, une liberté de l’âme et du corps. Qui dit fête dit perte, manque à gagner, dépense. Il faut accepter de perdre mais les plus riches, dans cet exercice, ne sont pas forcément les plus fortunés : « la fête est essentiellement un phénomène de la richesse, non pas de l’argent, bien sûr, mais de la richesse existentielle[15] ». Les pseudo-fêtes se caractérisent, à l’inverse, par « un gaspillage absurde et excessif de ce qu’a rapporté le travail, le débordement qui submerge toute rationalité ». La fête véritable consiste en une perte ou plutôt un don. Mais à qui donner et surtout pourquoi donner ? Pieper affirme, de manière très large, qu’ « on ne renonce à quelque chose qu’en raison de l’amour[16] ». « Ubi caritas gaudet, ibi est festivitas : où l’amour se réjouit, là est la fête[17] », écrit saint Jean Chrysostome. Mais de quel amour et de quelle joie parle-t-on ? Pieper en vient à l’élément central de son développement : l’assentiment à l’être.
Derrière la joie festive qui s’enflamme dans le concret, il y a toujours un assentiment intégral, un consentement plein et universel, qui s’étend au monde dans son ensemble, aussi bien à la réalité des choses qu’à l’existence de l’homme lui-même. Ce consentement, bien entendu, ne se donne pas nécessairement à travers une réflexion consciente ; et il a moins encore besoin d’être explicitement formulé. Il est cependant le seul fondement de la fête, quel que soit l’événement fêté in concreto[18].
Pieper considère que ce oui ou cet amen est le fondement ultime de la fête : le « motif festif » par excellence. « Un tel ‘‘Amen’’ ne saurait faire abstraction de ce qu’il y a d’effroyable dans le monde. Son sérieux ne se manifeste que dans la confrontation avec le mal dans l’histoire[19]. » Dans la fête prime le oui envers et contre tout : « La fête vit de l’affirmation. Même les messes de funérailles, ni ‘‘le jour des morts’’ ni surtout le Vendredi Saint ne sauraient revêtir le caractère de fête, sinon sur fond de cette certitude : le monde et l’existence sont toujours d’aplomb[20]. » Une fête n’est pas toujours gaie mais la joie l’emporte toujours sur la tristesse, le oui sur le non : « Dans son noyau essentiel, la fête ne consiste en rien d’autre qu’à vivre ce consentement. Célébrer une fête signifie : célébrer le oui au monde, qui a déjà lieu tous les jours, mais pour un motif spécial et d’une manière qui sort l’ordinaire[21]. »
III. La fête comme louange de Dieu
La fête véritable est une manière de dire oui au monde mais aussi et surtout à Dieu. Voilà son origine, selon Pieper, et sa destination. Le passage du plan métaphysique et anthropologique au plan théologique se fait, comme souvent chez Pieper, insensiblement, comme si la chose allait de soi, et sans justification particulière. À la fin du troisième chapitre, Pieper énonce ainsi la conséquence qu’il dégage de ses observations précédentes :
On peut l’étager sur plusieurs niveaux. Premièrement, il est impossible de rencontrer un oui au monde qui soit aussi radical que la louange de Dieu, la célébration du Créateur de ce monde dans son ensemble ; un assentiment plus fort, plus inconditionnel que celui-ci, n’est pas même concevable. Deuxièmement, si le cœur de la fête consiste en ce que les hommes vivent l’accord avec tout ce qui est, alors il n’est pas de forme plus festive de la fête que la célébration religieuse. Le revers de la médaille est que — troisièmement — il ne peut y avoir de destruction plus mortifère, plus désespérée du festif que le déni de la louange cultuelle ; ce ‘‘non’’ éteint l’étincelle à laquelle la flamme déjà mourante de la fête pourrait être ranimée[22].
Pour Pieper, « la fête religieuse est la forme la plus festive de la fête ». Les fêtes séculières existent, les fêtes profanes, en revanche, sont des oxymores : « Il y a des fêtes séculières, mais point de fêtes purement profanes. Ce qui suppose non seulement qu’il ne s’en rencontre pas de facto, mais plus encore qu’il ne peut logiquement y en avoir. La fête sans les dieux est un non-concept (comme un cercle qui n’aurait pas de centre)[23]. »
Les fêtes d’État, purement légales, ne sont que des commémorations. Ces fêtes sont mortes parce qu’elles ne s’inscrivent pas dans une tradition vivante[24]. Une fête n’est digne de ce nom, selon lui, qu’à condition d’être reliée, même très indirectement, au culte divin. La fête est religieuse, sacrificielle. Elle ouvre l’homme à un autre monde : « En célébrant une fête, l’homme franchit les barrières de l’existence temporelle et locale[25]. » Cette ouverture n’est pleinement réalisée qu’en christianisme lorsque le temps des hommes s'ouvre dans l’éternité de Dieu. Pieper a des pages très belles sur le « jour que fit le Seigneur » (Ps 117, 24). L’objet de la fête véritable n’est pas inventé par l’homme mais reçu de Dieu : « l’homme peut sans doute organiser une fête, mais il ne saurait créer ce qui est à fêter. Ni le motif festif ni l’attrait qui incite à célébrer ne dépendent de ses pouvoirs[26]. » La fête suppose le don et plus précisément le don de Dieu.
Autour de ces trois thèses — la fête ne s’oppose pas au travail mais en découle ; la fête est au consentement au monde ; la fête véritable est religieuse et plus précisément chrétienne — une multitude d’idées gravitent et donnent au livre sa saveur. On peut noter, entre autres, les développements sur l’art et la fête dans le chapitre VI ou bien encore, au chapitre VII, les notes passionnantes sur les fêtes instituées par la Révolution, comme la fête de la Raison ou la fête de l’Être suprême, simulacres qui confirment plus qu’elles n’infirment le lien indissoluble de la fête et du culte. Ces fêtes sont, pour Pieper, les contre-exemples parfaits de la fête, les anti-fêtes par excellence. Il faut que l’homme moderne occidental tire la leçon de ces échecs et qu’il reconnaisse sa dépendance à l’égard de Dieu pour être heureux et se réjouir :
La fête est rendue ici impossible parce que l’homme prétend à l’auto-suffisance. Il ne veut pas reconnaître la bonté des choses, qui va bien au-delà de tout bénéfice concevable. Ce n’est que par la bonté de la réalité dans son ensemble que tous les autres biens particuliers commencent à devenir désirables, et cette bonté première, l’homme n’est jamais en état ni de la produire lui-même ni de la réduire au bien-être social ou individuel. Il n’y prend réellement part que dans la mesure où il la reçoit comme don. Et la seule manière d’y répondre avec justesse est la louange de Dieu dans la célébration d’un culte. En un mot, c’est le refus de la louange cultuelle qui dessèche la fête à sa racine[27].
Il convient, pour finir, de saluer, outre la traduction très fluide, la préface de F. Hadjadj. Son intérêt réside autant dans la présentation des idées de Pieper que dans le développement et le prolongement de sa réflexion. Hadjadj se concentre sur « le motif festif » par excellence, celui de l’assentiment au monde, en s’interrogeant, en particulier, sur la fête d’anniversaire : « Pourquoi fêter la naissance d’un mortel ? Et même s’il est énarque et ministre de l’intégration sociale, ne conviendrait-il pas mieux de pleurer ? C’est la question à laquelle Joseph Pieper s’efforce de répondre dans ce petit essai implacable et jubilatoire[28]. » Cette question est, en effet, abordée par Pieper mais elle n’a pas la place centrale que lui donne Hadjadj. Aussi faut-il voir, dans cette préface, un texte important du philosophe qui poursuit ici sa réflexion sur la génération, la paternité, la filiation et la famille.
Celui-ci remarque que la célébration de l’anniversaire de naissance ne va pas de soi. Cela suppose de connaître sa date de naissance, ce qui réclame de s’en remettre à la mémoire d’autrui et, par conséquent, de faire confiance à ceux qui nous précèdent et nous engendrent. Une date suppose également un calendrier, c’est-à-dire une certaine organisation sociale du temps. L’objet de la fête, enfin, pose question. Pourquoi célébrer le jour de la naissance et ne pas préférer, par exemple, celui de sa conception ? Ne serait-ce pas réduire le mystère de la vie à sa partie visible ? La naissance, enfin, d’un homme est-elle si digne d’être célébrée ? « Moralement, fêter un anniversaire suppose trois choses : primo, qu’il est bon d’être né ; deuxio, qu’il est bon de prendre une année de plus ; tertio, que le simple fait d’être né, et non celui d’avoir vécu dans la justice, ou de mourir en état de grâce, suffit à une célébration collective et sans réticence[29]. »
Le premier point n’a rien d’évident. Ne faudrait-il pas, à la manière des Thraces, selon Hérodote, célébrer dans les larmes la naissance, prélude à tant de maux et de peines, et se réjouir de la mort, prélude d’une félicité parfaite ? « La faute de logique est assez évidente : comparer le fait d’être né avec le néant équivaut à comparer quelque chose avec le rien, et donc à ne rien comparer. Le néant ne se situe pas sur l’échelle des réalités positives. Il ne saurait être ‘‘mieux’’ que quoi que ce soit[30]. » La vie ne peut être comparée à la mort : « La vie naissante ne peut être critiquée que par comparaison avec la vie véritable, et non avec le néant[31]. » Ce point conduit au deuxième présupposé de la fête d’anniversaire dégagé par Hadjadj : est-il bon de vieillir ? Le vieillissement semble un mal. Mais on peut considérer aussi qu’avec l’âge viennent l’expérience, la sagesse, le recul, une meilleure connaissance de soi, des autres et des choses, etc. La vieillesse peut être profitable mais il ne faut pas rester à cette vision utilitariste des âges de la vie. Il convient d’acquiescer au temps qui passe et au devenir. La troisième question posée par la célébration de la naissance est difficile. Ne devrait-on pas célébrer la naissance à la grâce ou la naissance au ciel, comme le faisaient les chrétiens, plutôt que la naissance à la vie terrestre ? Les deux seules personnes, dans la Bible, qui fêtent leur anniversaire sont Pharaon et Hérode. N’est-ce pas le signe d’une fête égocentrique et narcissique ? Pour concilier les différents points de vue, Hadjadj dit que « le jour de ma naissance est saint, non parce que je le suis déjà, mais parce qu’il constitue un appel à la sainteté. Ma venue au jour m’indique que je dois venir à la pleine lumière. Le moment où je deviens visible m’incite à devenir digne de la gloire. La seule manière de fêter ma naissance est d’entrer plus avant dans la justice[31]. » Hadjadj, à la suite de Pieper (et de Rémi Brague[33]), voit dans la célébration de la naissance un acquiescement à la vie reçue, une gratitude à l’égard du bien qu’est l’existence : « À quoi bon être né, à quoi bon même faire le bien, s’il n’est pas bon d’être, tout simplement ? Il faut que l’existence en elle-même, et donc celle de toutes les choses dans leur admirable interdépendance, soit bonne, pour qu’on puisse vraiment dire ‘‘bon anniversaire’’ ou même seulement ‘‘bonjour’’[34]. »
Fr. David Perrin, o.p.
[1]Cf. Philippe Muray, Après l’Histoire I [1999], dans Essais, édition annotée par Vicent Morch, Paris, Les Belles Lettres, Paris, 2010, p. 82-114 ; Id., Festivus festivus. Conversations avec Élisabeth Lévy, Paris, Fayard, 2005, p. 11 : « Ce festivocrate de la nouvelle génération qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens a succédé à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive à la façon dont Sapiens sapiens est celui qui sait qu’il sait ; et s’il a fallu lui donner un nouveau nom, ce n’était pas dans la vaine ambition d’ainsi inventer un nouvel individu mais parce que ce nouvel individu était bel et bien là, partout observable, et qu’il reléguait déjà son ancêtre Homo festivus au musée des âges obscurs du festivisme taillé. » ↩
[2] Joseph Pieper, Dire oui au monde. Une théorie de la fête, traduction française par Fabrice Hadjadj et Jean Granier, préface de Fabrice Hadjadj, Paris, Salvator (coll. « Philanthropos »), 2022, p. 39. ↩
[4] Platon, Les Lois, II, 653d [trad. L. Brisson et J.-F. Pradeau, Œuvres Complètes, Paris, Flammarion, 2008, p. 710] : « Mais les dieux, prenant en pitié l’espèce humaine naturellement soumise à tant de labeurs, ont institué, comme une halte au milieu de ces labeurs, l’alternance des fêtes en leur honneur (...). » ↩
[8] Il le fait un peu plus dans Le loisir, fondement de la culture, traduit de l’allemand par Pierre Blanc, préface de Bernard N. Schumacher, Genève, Ad Solem (coll. « Joseph Pieper »), 2007. ↩
[9] J. Pieper, Dire oui au monde, op. cit., p. 41.
[10] Ibid., p. 41-42. Comme le résume F. Hadjadj avec ironie : « Pour qui n’a qu’un ‘‘taf’’, il ne peut exister que des ‘‘teufs’’. » F. Hadjadj, op. cit., p. 26. ↩
[17] Cette phrase est bien de saint Jean Chrysostome mais elle n’est pas tirée des homélies sur la pentecôte mais d’une homélie « Sur son retour d’Asie » : « Ubi enim caritas gaudet, ibi est festivitas et ubi recepi laetantes filios, maximam celebro festivitatem. Etenim et illa festivitas caritas est. » Jean Chrysostome, « À son retour d’Asie », § 14 [éd. Antoine Wenger, « L’homélie de saint Jean Chrysostome ‘‘À son retour d’Asie’’. Texte grec original retrouvé. Édition et commentaire. », Revue des études byzantines 19 (1961), p. 119-121]. ↩
[24] J. Pieper, Le concept de tradition, traduction de Claire Champollion revue par Pierre Blanc avec la collaboration de Pierre Lane, introduction de Kenneth Schmitz, Genève, Ad Solem (coll. « Joseph Pieper »), 2008. ↩
[25] J. Pieper, Dire oui au monde, op. cit., p. 89. ↩
[28] F. Hadjadj, « Préface », op. cit., p. 8-9. ↩
[33] Cf. Rémi Brague, Les Ancres dans le ciel. L’infrastructure métaphysique de la vie humaine, Paris, Le Seuil (coll. « L’ordre philosophique »), 2011. ↩