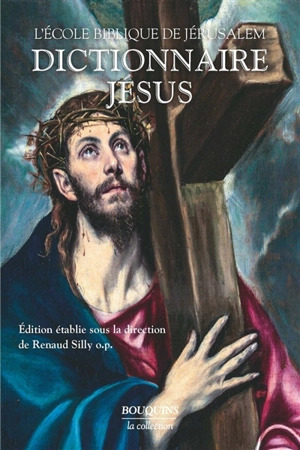Le Figaro Histoire - Vous avez dirigé chez Bouquins la réalisation d’un Dictionnaire Jésus qui fait le point sur l’état de la recherche contemporaine sur la vie et la personne du Christ. Quel regard jetez-vous sur la biographie que vient de lui consacrer Michel Onfray ?
Renaud Silly - En couverture du livre, un Christ de Fra Angelico, bafoué, giflé, aveuglé. Un Jésus qui « n’avait plus rien d’un homme » (Is 52,14). Tout un programme. Lorsque l’on ouvre cette « biographie d’une idée » par Michel Onfray, on suppose avec une générosité où pointe une dose d’imprudence que l’on a affaire à un philosophe réfléchissant sur l’essence de Jésus. Mais alors, pourquoi est-il allé se fourvoyer dans une revendication aussi entêtée que peu étayée de la théorie dite « mythiste » selon laquelle Jésus n’aurait pas existé ? L’hypothèse dont part Michel Onfray postule en effet que c’est l’ensemble de la biographie de Jésus, depuis la conception à Nazareth, jusqu’à sa Pâque à Jérusalem en passant par la naissance à Bethléem et le ministère en Galilée et en Judée, qui constituerait un mythe religieux sans base historique. Il serait du même genre que la descente d’Orphée aux Enfers, ou de la naissance de Persée d’une pluie d’or couvrant sa mère Danaé.
Cette théorie n’est pas nouvelle. Apparue à la fin du XVIIIe siècle, elle repose d’une part sur la comparaison des miracles évangéliques avec des parallèles plus ou moins forcés dans les mythologies méditerranéennes, et d’autre part sur l’affirmation que les épisodes de sa vie, même non miraculeux, ne remplissent pas les critères permettant de les déclarer historiquement attestés.
Le problème est que déclarer comme il le fait la théorie mythiste ultra-minoritaire chez les historiens, c’est complaisance, courtoisie ou euphémisme. Elle est aussi légitime dans son domaine que la fixité des espèces ou l’efficacité de la poudre de perlimpinpin dans le leur. Il ne suffit pas de répéter « l’Europe, l’Europe » en sautant comme un cabri pour que la paix s’installe sur le continent. Il ne suffit pas non plus de marteler que ceux qui tiennent l’existence historique de Jésus le font par crédulité ou par intérêt – pas plus que l’appât du gain ou un souci apologétique ne guidaient le pieux chanoine Georges Lemaître lorsqu’il découvrait la théorie du Big Bang qui abattait le consensus scientifique sur l’éternité du monde - pour que cela soit vrai. La thèse mythiste est en réalité une théorie non-scientifique, sinon la science historique n’a plus rien à dire sur le passé. Si les témoins à notre disposition ne suffisent pas en effet à attester l’existence de Jésus, alors on n’est plus sûr de rien. La théorie mythiste, c’est le scepticisme absolu, c’est le doute universel, c’est condamner la science à ne manipuler que des concepts creux et abstraits. Dans le métavers où Jésus n’a pas plus existé que Michel Onfray ou aucun d’entre nous, Constantin cède au pape la souveraineté temporelle sur l’Italie, et Emile Ajar n’est pas Romain Gary.
Qu’est ce qui vous permet de réfuter cette thèse de manière aussi absolue ?
Aucun historien ne croirait devoir prendre aujourd’hui la peine de prendre la plume pour la réfuter. Il n’en fut pas toujours ainsi. Au début du XXe siècle, sous sa forme la plus aboutie chez Arthur Drews et Paul-Louis Couchoud, elle ne s’était pas encore exclue du cercle de la raison. Il était encore défendable scientifiquement, et admissible, voir souhaitable culturellement, que le « christianisme » passât pour un phénomène séparé d’Israël, qui aurait conquis son indépendance en subvertissant le monothéisme juif. Paul de Tarse, regardé à tort comme un apostat, était alors considéré par certains comme le prophète d’une religion syncrétique et nouvelle, modelée sur les cultes hellénistiques à mystères, vénérant un « Seigneur Jésus » comme d’autres les Dioscures ou Héraclès. Ces cultes païens reposent sur un mythe fondateur qui exprime des vérités religieuses intemporelles et voile dans un récit des révélations sublimes, inaccessibles au profane. On sait la fécondité de ce mode d’expression, jusque chez les plus grands philosophes. Le problème est que cette définition du mythe dont la théorie du même nom a besoin pour y réduire le phénomène Jésus est inadéquat pour rendre compte de la foi juive à quelque étape que ce soit de son histoire, et moins que jamais au Ier siècle.
Le judaïsme connaît des légendes, ou des allégories, et l’historien peut à bon droit s’interroger sur la nature légendaire d’un certain nombre d’épisodes de la Bible. Mais les allégories juives ont toujours une portée historique : Daniel voit un colosse aux pieds d’argile, une statue d’or, d’argent, d’airain et de fer qui désigne sous forme imagée des entités historiques précises (royaumes, princes etc.). Il ne s’agit donc pas de mythes au sens grec. Or, la théorie mythiste exige à l’inverse que le Nouveau Testament dans son ensemble puisse être tenu pour une création grecque. Or, tous les auteurs du Nouveau Testament sont juifs, le mode d’expression mythique et le type religieux qui l’accompagne leur sont étrangers ; totalement juif, Paul de Tarse qui « éprouve une grande tristesse en [s]on cœur et souhaiterai[t] même être séparé du Christ pour [s]es frères, de [s]a race selon la chair, eux qui sont Israélites » (Rm 9,2-4), ce même Paul qui « selon la justice que peut conférer la pratique de la Loi de Moïse [est] un homme irréprochable » (Ph 3,6). Totalement juif, Jean l’évangéliste que l’on présentait parfois à l’époque de Drews et Couchoud comme un mystique hellénisé, mais dont une étude mieux informée montre désormais qu’il était pétri de judaïsme sacerdotal (il était même « parent du grand prêtre » - Jn 18,16). La théorie mythiste suppose contre toute vraisemblance que ces juifs se soient entièrement paganisés, qu’ils aient adopté des modes de pensée à l’opposé de leur formation, sans aucun équivalent dans le judaïsme de ce temps : si on y trouve des allégories, bien bibliques d’ailleurs, les textes de Qumrân, les apocryphes de l’Ancien Testament, le judaïsme postérieur ne contiennent pas de mythes.
En outre, Onfray déclare que ces juifs devenus païens gardent comme système de référence exclusif … l’Ancien Testament ! Le corpus de textes le plus réfractaire au mythe grec ! Est-ce sérieux ? Donc, de vaguement soutenable qu’elle pouvait être il y a plus d’un siècle, à une époque où l’on ne se gênait pas pour dire que la séparation du christianisme du judaïsme avait été une libération, la théorie mythiste ne résiste plus à une contextualisation plus poussée du Nouveau Testament dans le monde hébraïque. C’est l’inverse qui est vrai : une meilleure connaissance de ce contexte littéraire montre que le mouvement de Jésus et les auteurs du Nouveau Testament se rattachent par toutes leurs fibres intellectuelles et artistiques à ce judaïsme riche, créatif et multiforme du Ier siècle ; leur conscience d’eux-mêmes est intégralement et peut-être même exclusivement juive. La théorie mythiste va donc à rebours de l’énorme effort d’histoire, d’archéologie, de philologie pour contextualiser le Nouveau Testament. C’est une théorie rétrograde et arriérée.
Mais quelles preuves concrètes avons-nous que Jésus ait bel et bien existé ?
Du côté plus classique des moyens qui permettent d’établir un fait du passé, la théorie mythiste suppose à tort que les sources anciennes ne suffisent pas à prouver que Jésus a existé. Mais de quel droit un hyper-criticisme n’applique-t-il pas au Nouveau Testament le critère ordinaire d’attestation historique, à savoir l’existence de témoins concordants et indépendants ? Qu’est-ce qui justifie un traitement spécial ? Les évangélistes font de grands efforts pour situer chronologiquement les événements : naissance de Jésus, début de la prédication du Baptiste. On peut contester leurs résultats, dire qu’ils se sont trompés, mais comment déclarer mythe ce qui revendique ce degré d’enracinement dans l’histoire ? Matthieu et Luc situent la naissance de Jésus à Bethléem ; pour le reste, leurs Évangiles de l’enfance ont peu de points communs. Ces deux évangélistes ne se connaissaient pas. Ce sont donc, sur la question de l’existence même de Jésus, des témoins concordants et indépendants de la tradition. Ils situent indépendamment la naissance de Jésus à la fin du règne d’Hérode le Grand.
Prenons encore l’exemple des paroles. Paul de Tarse s’appuie parfois, dans ses épîtres, sur des « paroles du Seigneur » pour répondre à des questions de dogme ou de morale soulevées par des fidèles. Il en use de manière libre et créative, les paroles de Jésus à ce stade n’étant pas consignées dans nos évangiles, lesquels n’existent pas encore. Or ces paroles de Jésus apparaissent de fait sous des formes voisines, mais parfois pas du tout, dans les évangiles canoniques, souvent comme de petits groupements détachés de leur contexte narratif. Là encore, on est en présence d’attestations indépendantes de l’enseignement de Jésus, par exemple sur l’indissolubilité du mariage, sur le pardon des offenses, tous points où il professait un enseignement original. Les mythistes vont-ils affirmer que les évangélistes ont emprunté à Paul ces paroles du mythe Jésus et composé à partir de lui ses discours ? Mais d’où vient que ce matériau circule sous une forme différente chez Matthieu, chez Marc, chez Luc et chez Paul lui-même ? Rien ne prouve que l’évangéliste Matthieu connût Paul. Alors ? Ces attestations font bien plutôt remonter les paroles de Jésus à une tradition commune déjà en place avant Paul, partiellement collationnée dès les années 40. On n’est que dix ou quinze ans après Jésus. Quoi de plus raisonnable que de penser que leur source commune, c’est Jésus ? De plus, le schéma de transmission correspond à l’enseignement dans les Églises primitives tel qu’il ressort des épîtres de Paul et des Actes des Apôtres.
On pourrait faire le même raisonnement non seulement sur les lieux de la prédication de Jésus, sur la physionomie générale de son activité publique, et bien entendu sur sa Passion : pluralité d’attestation, discordances qu’il faut expliquer.
Enfin, avec Jean, on a un autre témoin très à part des autres puisque les formes de son langage sont indépendantes. Il donne une version des faits assez différente dans le détail de celle livrée par les Synoptiques – par exemple sur l’appel des disciples, sur la chronologie de la Passion, sur les causes de l’hostilité que Jésus a attirée sur lui… Ces discordances sont celles que l’on peut attendre de sources indépendantes. C’est leur accord forcé qui ferait suspecter un dessein concerté. Elles justifient le travail de l’historien, non sa démission sous l’explication trop facile que cela n’a pas existé sous prétexte qu’il existe des contrariétés. La figure de Socrate chez Platon est différente de celle qu’il arbore chez Xénophon, tous deux l’ayant personnellement connu. Est-ce une raison pour douter de l’existence de Socrate ? Les usines à gaz de la théorie mythiste explosent avant même qu’on les ait terminées.
L’existence directe de Jésus est en outre attestée par au moins un observateur extérieur, étranger au christianisme, qui ne dépend ni des évangiles ni de leurs sources et qui écrit au Ier siècle . C’est l’historien juif Flavius Josèphe, traité miséricordieusement de « traître à son peuple » par Onfray, sans doute pour discréditer son témoignage. Voilà un des arguments ad hominem dont il s’est fait une spécialité, puisque les autres sont absents. On pourrait attester l’existence de Jésus sur la seule base des Antiquités de Josèphe, même si rien d’autre n’avait survécu de Jésus. Dans un passage où il traite de Jacques, chef de la première Église de Jérusalem, il le qualifie de « frère de Jésus, appelé Christ ». Le participe « appelé » suggère dans ce contexte une réticence de l’auteur envers le titre de «Christ » appliqué à Jésus qu’il est impossible d’attribuer à un interpolateur chrétien. C’est bien du Flavius Josèphe, et il évoque Jacques le « frère du Seigneur » mentionné par Paul de Tarse (Ga 1,19). Ailleurs Flavius consacre un petit développement spécifique à Jésus, le fameux témoignage flavien, dont tout le monde reconnaît qu’il est partiellement interpolé par des mains chrétiennes plus tardives. Mais son noyau est authentique et c’est peut-être lui qui a justifié la transmission exclusivement chrétienne des œuvres de Flavius Josèphe, ignoré du judaïsme postérieur. Expurgé de ses interpolations, le témoignage flavien livre un portrait original de Jésus, qui n’est pas attesté par les sources chrétiennes : c’est la preuve que Flavius Josèphe dispose d’une information indépendante. Il présente Jésus comme un « sage », épithète inconnu des Évangiles et de la littérature chrétienne primitive. Lorsqu’il déclare que Jésus « était le Christ », l’imparfait signalant que l’auteur considère cette prétention comme révolue empêche d’y voir une confession de foi. Cette prise de distance n’est pas celle que l’on attend d’un interpolateur, elle est conforme à l’honnêteté d’un historien. C’est encore la main de Josèphe qui se signale ici.
Que vaut l’argument selon lequel on ne pourrait prendre au sérieux le témoignage des auteurs du Nouveau Testament, qui, étant eux-mêmes chrétiens, seraient par-là juges et parties ?
Traiter les Évangiles en littérature partisane est vain. Si l’histoire devait exclure a priori tous les témoins non-neutres pour ne garder que les impartiaux, elle n’aurait plus rien à sa disposition. Elle garderait les mains pures, mais n’aurait plus de mains. L’historien met son humble fierté à critiquer ses sources, à rendre compte de leurs discordances, pour en extraire l’information qu’elles recèlent, y compris lorsqu’elle contient des éléments mythologiques, des prodiges, des miracles, comme c’est le cas des Vies de Jules César, d’Auguste ou de tous les grands personnages de l’Antiquité méditerranéenne. La science peut formuler l’hypothèse que les Évangiles sont de mauvaises biographies, mais elle établit qu’ils sont des biographies. Les Anciens connaissaient certes les biographies de personnages légendaires, comme celles consacrées par Plutarque à Romulus et à Thésée. Les Évangiles seraient-ils quelque chose d’analogue ? La comparaison est fallacieuse, Plutarque pouvait se contenter de mettre en ordre une multitude de légendes qui existaient déjà. Ici, la théorie mythiste se heurte à une contradiction : elle suppose que les Évangiles sont les biographies d’un personnage légendaire … dont ils auraient eux-mêmes créé la légende ! Elle suppose donc que les Évangiles soient des Vies fictives d’un personnage qui n’avait même pas d’existence myth[olog]ique avant qu’ils ne lui donnent forme ! Et ce personnage aurait les mêmes traits dans les diverses traditions indépendantes qui découlent de lui ! Les nombreux auteurs du Nouveau Testament qui ne se connaissaient pas entre eux s’accorderaient quand même sur des données biographiques de cet être fictif … Où est l’archétype littéraire leur ayant servi de source commune ?
Michel Onfray semble penser que la figure de Jésus aurait pu être composée à partir de fragments de la Bible hébraïque. Or, il est de fait que le Jésus des Évangiles ne cesse de se référer à elles, et que les rédacteurs des Évangiles ont insisté sur le fait qu’il les avaient accomplies par son enseignement et sa vie...
Il est un peu injurieux pour l’Ancien Testament de le réduire à n’avoir fourni au Nouveau que les tesselles d’une mosaïque. Mais c’est surtout n’apporter aucune attention à la manière dont le Nouveau use de l’Ancien. On constate en effet que la constellation de références à l’Ancien Testament se fait plus épaisse, dans les Évangiles, à l’approche des événements de la vie de Jésus qui font le plus difficulté à la foi placée en lui comme en Dieu. À l’aune de cette foi, il est scandaleux qu’il ait reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain le baptême des pécheurs, ou qu’il soit mort abandonné de tous, selon un supplice ignominieux. Aussi le baptême et la Passion sont-ils les lieux les plus saturés de références à l’Ancien Testament, afin de montrer que ces événements sur lesquels la foi dans la divinité du Christ peut achopper correspondent en réalité à un plan providentiel de Dieu, tracé dans ses grandes lignes par les prophètes. Mais prétendre que la Passion a été inventée de toutes pièces pour illustrer l’accomplissement de l’oracle du Serviteur souffrant (Is 52-53), est à peu près aussi logique que d’affirmer qu’un fils peut enfanter sa mère et une fille engendrer son père. Les historiens nomment « critère d’embarras » les lieux où un fait est attesté par la difficulté qu’il représente pour ceux qui le rapportent. C’est donc qu’il est suffisamment établi pour qu’ils ne puissent pas l’escamoter. C’est parce que l’idée d’un dieu mourant sur la Croix paraissait « scandale pour les Juifs, folie pour les païens » (1 Cor 1,22-24) que l’épisode de la Passion ne peut manquer d’avoir été authentique.
Le refus nécessaire de la théorie mythiste ne doit pas non plus conduire à jeter le bébé avec l’eau du bain. Ce n’est pas seulement dans les passages faisant difficulté que la biographie de Jésus fait référence aux Écritures. Celles-ci fournissent aux Évangiles un idiome, un système de références, un arrière-plan explicatif. Tout simplement parce que c’est la culture commune des auteurs du Nouveau Testament. Selon Platon, Homère est le pédagogue de la Grèce. Alexandre le Grand voulait imiter et dépasser Achille. Est-ce que les traits achilléens de la biographie d’Alexandre doivent faire conclure qu’il est un mythe élaboré à partir de son modèle homérique ? C’est ridicule. Il n’y a pas plus de raison de le faire quand les Évangélistes soulignent les parentés entre le destin de Jésus et celui de Moïse. À la différence de l’Iliade et de l’Odyssée, l’Ancien Testament est tout entier prophétique, de sorte qu’il a formé les consciences juives à l’espérance de son accomplissement – catégorie typiquement juive. Dès lors que la foi a cru que ces promesses se réalisaient en Jésus, quoi d’étonnant à ce que la méditation érudite de ses biographes multipliât les traits qui le font ressembler à Moïse, à David, à Salomon ? On peut contester sur des critères esthétiques l’harmonie d’ensemble de ce procédé. Mais en aucun cas en conclure que c’est une biographie rédigée pour les accumuler sur un être fictif. L’Ancien Testament fournit un ensemble inouï de réflexions religieuses, de motifs d’espérance, de promesses de salut, mais pas la base pour la biographie suivie d’un personnage fictif ! Si Onfray acceptait d’entrer dans un débat qu’il écarte avec dédain, sa position reviendrait à peu près à la légende, apparue au IVème siècle, selon laquelle les 70 traducteurs de la version grecque de l’Ancien Testament, isolés les uns des autres, auraient fourni le même texte, faisant de la Septante un miracle littéraire. Au moins avaient-ils un travail unique à opérer sur une seule source ! La thèse mythiste est encore plus spéculative que la légende sur l’origine de la Septante.
L’ouvrage de Michel Onfray se limite-t-il à la réactivation de cette thèse mythiste ? Ne lui offre-t-il pas aussi l’occasion de donner sur le christianisme des aperçus originaux ?
Qu’est-il allé faire dans cette galère ? Pourquoi Onfray défend-il bec et ongles le recours à une thèse non-scientifique ? Mieux : pourquoi est-elle nécessaire à son propos ? Par opportunisme, d’abord. On appelle « l’effet blouse blanche » l’autorité exercée par les médecins en vertu non de leur art mais de leur vêtement. Pascal parlait d’hermine et de brocatelle, dont se paraient les magistrats du Parlement. C’est l’effet visé par Onfray lorsqu’il excipe de la « thèse mythiste », comme si le simple fait qu’elle est une théorie suffisait à lui conférer une légitimité scientifique. Mais c’est l’inverse qui est vrai. Onfray revendique cette opinion parce qu’elle le dispense de prouver aucune des fantaisies qu’il déverse par tombereaux. La thèse mythiste est le paravent, l’écran de fumée du caractère absolument non-scientifique, arbitraire, voire obscurantiste de sa « théorie de Jésus ». Mettons-nous à sa place. S’il avait concédé à Jésus les bribes les plus minimes d’historicité, il aurait dû composer son livre à partir d’elles, puisqu’il se donne la tâche d’écrire une « biographie ». On imagine son embarras. Que retenir dans ce donné foisonnant et selon quels critères ? Le prêcheur du sermon sur la Montagne ? Le thaumaturge ? Le révélateur de Dieu ? Le crucifié ? Le charpentier ? Le bon vivant ? L’ami des publicains et des pécheurs ? Le purificateur énergique du culte profané par les marchands du Temple ? Le prophète apocalyptique ? On devine sans peine Onfray bâiller d’ennui devant l’exercice qui aurait requis de sa part un minimum d’objectivité et de rigueur intellectuelle : il aurait supposé un travail à quoi suffit à peine une vie. Même sa dette filiale envers Lucien Jerphagnon, qui lui avait conseillé d’écrire un Jésus, ne valait pas tant : il s’en acquitte avec une extrême légèreté. Sortons de derrière les fagots une ’thèse mythiste’ qui offre le prétexte rêvé pour affirmer n’importe quoi. Mais Onfray aurait pu avertir son lecteur qu’il ne trouverait rien d’autre dans le livre que le Jésus imaginaire de Michel Onfray. Même Issa des écrits sacrés de l’islam, fils d’une Mariam qui semble confondue avec Hagar la servante d’Abraham, a plus à voir avec Jésus de Nazareth que l’inquiétante chimère.
Cette prémisse méthodologique est indispensable à la lecture du livre. Onfray livre le Jésus issu de sa méditation à l’exclusion de tout personnage réel. Son Jésus rêvé – ou celui de son cauchemar.
À quoi ce Jésus ressemble-t-il ?
Comme on l’a vu, Onfray discrédite le témoignage de Flavius Josèphe qualifié de « traître à son peuple ». C’est la première apparition d’une petite musique qui va peu à peu crescendo : ce Jésus imaginaire est une machine de guerre contre le judaïsme. C’est la thèse de fond. Sans surprise, le philosophe Onfray sollicite l’Aufhebung, cette dialectique hégélienne qui nie une chose tout en prétendant l’assumer et la dépasser. L’Idée dont on nous dresse la biographie n’a pas d’autre rapport à la Loi juive, qu’Elle abolit (– on est surpris d’apprendre à cette occasion que « Jésus » aurait considéré les sacrifices juifs du Temple comme une « coutume païenne » - cf. p.149 la prodigieuse affirmation que Paul aurait fait brûler des rouleaux de la Torah, en digne précurseur des autodafés nazis). Comme le vrai Jésus affirme explicitement qu’il n’est pas venu « abolir la Loi mais l’accomplir » (Mt 5,17), la traduction de ce verset par Onfray lui fait dire son contraire. Désireuse d’enseigner une autre religion, « l’Idée » nihiliste d’Onfray transgresse consciemment et allègrement toutes les institutions les plus sacrées de la Loi juive, le sabbat, la circoncision, la majesté du Temple. Elle fait l’éloge du vol (p.185), enseigne la haine des parents (id.), se fait entretenir par des femmes douteuses (id.). Quand on vous disait que la « thèse mythiste » permet d’affirmer n’importe quoi, puisqu’elle n’interdit rien, sauf ce qui est raisonnable. Onfray n’a cependant pas la paternité de ce portrait de Jésus en contempteur nihiliste des valeurs communes, dont plusieurs apparaissent chez le polémiste Celse dès 180. Mais à la différence d’Onfray, Celse raisonnait selon les valeurs ordinaires d’un païen cultivé de son temps, il n’avait pas la prétention d’être historien. On pouvait l’excuser aussi de ne rien entendre à un Jésus juif, en un temps où pullulaient les sectes gnostiques.
La place manque en tout cas pour relever la somme inouïe de non-sens qu’Onfray multiplie à plaisir et qu’il se serait peut-être épargnés s’il avait consenti à penser Jésus et non à se contenter d’y laisser divaguer son esprit. Relevons tout de même le contresens absolu sur le sabbat. Jésus ne veut pas le transgresser comme un adolescent qui se livre à des provocations gratuites pour le plaisir de tester les limites fixées par les adultes. Si c’était le cas, il ferait des choses interdites : se déplacer sur une longue distance, allumer un feu etc. Or les pseudo-transgressions de Jésus le jour du sabbat sont toujours des guérisons. Il ne viole pas le Sabbat, au contraire il le porte à sa perfection en revenant à son essence religieuse, qui n’est pas un règlement arbitraire auquel on se plie pour des motifs identitaires. Le sabbat est en effet le moment où Dieu agit seul – comme on le voit avec le sabbat de la terre en Lv 25,6 désignant le fruit que la terre porte lorsqu’on ne la cultive pas. Le sabbat est indispensable à Israël pour lui rappeler que ce n’est pas son activisme qui le met en possession des biens de la terre, mais la générosité de Dieu qui comble gratuitement. Le sabbat est le grand jour de fête car c’est celui de l’agir salvifique et créateur où Dieu opère sans auxiliaire. En opérant des guérisons le jour du sabbat, Jésus revendique pour lui-même cet agir divin qui restaure et qui sauve. Où est la transgression, s’il possède de facto ce pouvoir divin sur le sabbat ? C’est ce qu’il veut dire lorsqu’il déclare qu’il est « maître du sabbat » (Mc 2,28). C’est une manière de dire qu’il opère comme Dieu.
Autre contresens, lorsqu’Onfray affirme que la douloureuse citation du Psaume 22 par Jésus crucifié (« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ») « abroge sa vie et son œuvre » ? Pourquoi dénier à un juif pieux qui meurt la consolation et le réconfort de réciter selon l’usage des agonisants des prières traditionnelles dans lesquelles sa sensibilité religieuse s’est développée ? Pour Onfray qui reprend encore des invectives de Celse, c’est indigne d’un dieu. Mais justement, la tradition a vu dans ces cris et cette déréliction la preuve que l’humanité de Jésus n’était pas feinte ou apparente. C’est aussi la preuve qu’il est un juif observant, qui fait confiance a priori aux institutions religieuses d’Israël - il paie d’ailleurs volontairement l’impôt dû au Temple cf. Mt 17,27.
Quelles sont les conséquences de cette séparation de Jésus d’avec le judaïsme de son temps ?
Miche Onfray le dit lui-même et je lui en laisse l’entière responsabilité tant le passage peut faire frémir non seulement un juif ou un chrétien, mais toute personne qui n’a pas abdiqué le sens naturel de la vérité : « la vie de Jésus a besoin de la mort des juifs qui ne sont pas le peuple déicide parce que c’est Jésus qui s’avère le juif judéocide – qu’on me permette ce néologisme pour fixer ma pensée » (p.211). Une telle phrase que je supplie Dieu de n’écrire jamais est l’apogée du livre et sa clef d’interprétation d’ensemble. Elle explique pourquoi Onfray tient à la théorie mythiste. Celle-ci, on l’a vu, ne peut se soutenir qu’au prix d’une paganisation / déjudaïsation radicale du Nouveau Testament, de ses auteurs et de Jésus lui-même. En les arrachant à leur intelligence, à leur sensibilité, à leurs espérances, à leurs amours, à leurs amitiés. Il n’y a aucun espace en effet en judaïsme pour des mythes qui seraient l’expression de vérités religieuses éternelles.
À l’inverse, contester la réalité de l’humanité du Christ, c’est le restituer à une potentielle assimilation païenne. Il ne peut y avoir en effet de Jésus païen s’il n’est privé de son corps, de sa chair juive disciplinée par les jeûnes et l’ascèse, par la chasteté et l’observance religieuse. Or il n’est pas inutile de rappeler qu’Onfray n’innove pas en la matière. Lorsqu’il écrit que Jésus « n’est pas né sur la terre », lorsqu’il lui prête « le corps d’un ange », lorsqu’il le définit comme « un concept qui agrège d’autres concepts », l’affirmation obsédante renvoie à des essais très anciens, attestés dès le Nouveau Testament, de contester la réalité de son humanité: « tout esprit qui confesse que Jésus n’est pas venu dans la chair n’est pas de Dieu », met en garde l’apôtre Jean (1 Jn 4,3). À cette époque, la déréalisation de la chair de Jésus visait à le diviniser plus facilement, tant les religiosités païennes se montraient souples et ouvertes à l’apothéose des héros. Ainsi de Paul et Barnabé qu’une foule non-juive enthousiaste après un discours brillant acclame comme Hermès et Jupiter, au point de vouloir leur offrir un sacrifice (Ac 14,12) ! Le christianisme aurait été différent s’il avait consenti au mythe : il serait devenu un culte métroaque supplémentaire, un nouvel avatar des mystères de Dionysos après tant d’autres. La voilà, la paganisation, la déjudaïsation, culturellement si facile et entraînante, gage de succès à court terme.
À cette aune, la théorie mythiste devient beaucoup plus sérieuse qu’il n’y paraît : c’est de l’histoire-fiction. Elle décrit le christianisme qui aurait pu advenir s’il avait consenti à s’émanciper de « l’olivier franc » sur lequel il a été « greffé : Israël » (Rm 11,16-19). Ou tel qu’il sembla brièvement au IIème siècle, quand l’Église des apôtres parut sur le point de céder à la déferlante de la Gnose. Celle-ci fascine Onfray. Avec elle il a le sentiment de toucher au but, c’est pourquoi il met sur le même plan que les Évangiles canoniques les apocryphes tardifs qui décrivent un enfant Jésus dans l’innocence d’une violence meurtrière. Si tous sont mythiques et n’ont pas à faire la preuve de leur réalité, cela n’est-il pas permis ? Ces tendances docétistes (affirmant que l’humanité de Jésus n’est qu’apparente) sont toujours liées à la tentative de fonder le christianisme par une séparation absolue d’avec Israël, comme un corpus de doctrine nouveau fondant des institutions, une foi qui se suffiraient à elles-mêmes. À l’inverse, la manière la plus efficace de les combattre dans l’Église a toujours consisté à valoriser le respect scrupuleux par Jésus des institutions juives, garantes ultimes de la vérité de sa chair : « Dieu a envoyé son fils, né d’une femme, né sujet de la Loi » (Ga 4,4). La judaïté de Jésus et la vérité de son humanité le préviennent absolument contre une mythification / divinisation à la mode païenne. C’est grâce à sa judaïté qu’il est le Verbe fait chair et non un homme divinisé. Privé de sa condition juive, ce pseudo-Jésus n’est plus qu’un dieu sans généalogie, sans histoire, sans enracinement, qui se promène parmi les hommes. Une idole païenne. Il a fallu payer cette abstraction en supprimant son humanité juive. Pas étonnant donc que le Jésus irréel d’Onfray soit « judéocide » et veuille « la mort des juifs ». L’éprouvant avatar du docétisme antique, passé par la mauvaise conscience nietzschéenne, c’est un Jésus antisémite et sa biographie fictive par Onfray. Le rendre à son judaïsme, c’est lui rendre son corps. L’en priver, c’est lui permettre de mener une existence idéale. Il a besoin d’anéantir le judaïsme pour exister abstraitement. Ce « Jésus » païen est en guerre inexpiable avec le judaïsme qui à tout moment l’oblige à reprendre la chair honnie. Que l’on concède un soupçon de judaïsme authentique dans le Nouveau Testament, et Jésus redevient un homme, un vrai, avec une chair « en tout semblable à la nôtre ». Blasphème pour Onfray. Cette abstraction irréelle livre une lutte éternelle à ce qui risque d’encombrer sa pure spiritualité.
Pour aller plus loin :
Le Figaro Hors Série, Jésus-Christ cet inconnu, mars 2020 (Acheter le numéro / Acheter le coffret).
Renaud Silly (dir.), Dictionnaire Jésus, Bouquins, 2021.